Principes du montage photo stéréo
(l'exemple du 6x13)
par
Henri PEYRE
Introduction
Faire un bon montage est d'autant plus
facile que la prise de vue a été bien réalisée. Aussi commençons-nous
cette partie sur le montage par quelques rapides conseils concernant la
prise de vue stéréoscopique. Puis la page évoque les principales
stratégies de montage des bons auteurs.
Nous expliquons notre propre méthode en image dans
une autre page.
Conseils pour la prise de vue stéréoscopique
Si vous utilisez un appareil non
stéréoscopique
- Utilisez obligatoirement un pied et
un rail comportant un niveau à bulle. Evitez de réaliser la paire de
vues au jugé. Choisissez un écart entre les 2 vues d'environ 6,5 cm.
Evitez tout objet en mouvement sur votre prise de vue.
Que vous ayez ou pas un appareil de prise
de vue stéréoscopique
En stéréo l'observateur de la vue
supporte mal une limitation de circulation du regard due à un manque de
netteté dans l'image. Autant en photo plate il est recommandé de jouer
de l'opposition du net et du flou, autant en stéréo la faiblesse de
profondeur de champ irrite à tous les coups le spectateur, le même qui
aurait apprécié d'avoir son regard conduit en photo plate : est-ce de
retrouver au milieu de cette illusion de relief la désagréable
impression qu'il doit changer ses lunettes ? En tous cas le fait est là.
Donc : essayez d'obtenir la plus grande netteté possible en tâchant
d'utiliser la plus grande profondeur de champ possible : si le sujet
est immobile, fermez au maximum le diaphragme et tant pis pour la
diffraction possible lors de l'utilisation d'un diaphragme très fermé.
Utilisez au mieux les
tables
de profondeur de champ) ; s'il y a des personnages en mouvement,
fermez le diaphragme au plus juste pour rester dans une vitesse
compatible avec les personnages en léger mouvement (1/50ème, 1/60ème de
seconde).
Comme vous risquez de devoir employer
des temps de pose longs, prévoyez un pied.
Réalisez systématiquement vos prises de
vue avec un niveau de sorte que la base des vues gauche et droite
soit au même niveau horizontal sur le film.
Si vous utilisez des diapositives, ne
tolérez aucune brûlure des hautes lumières : en cas de zone morcelée
avec des mi-ombres, réglez la pose comme si vous étiez entièrement en
zone ensoleillée. Sacrifiez les basses lumière, pas les hautes.
Suivez la règle du "trentième" :
pour cette règle issue de la pratique, si les 2 objectifs de prise de
vue sont écartées de 6,5 cm, n'acceptez aucun premier plan à moins
de 30 x 6,5 cm = 1,95 m
de votre appareil photographique. Vous ne pouvez outrepasser cette règle
que si les arrière-plans sont proches des premiers-plans ou si vous
prenez les photographies avec une focale plus courte et les regardez
avec une focale plus longue. C'est le cas si vous possédez par exemple
un deuxième appareil 6x13 de focale 55mm dont vous examinez les clichés
dans la même visionneuse que celle qui vous sert à regarder les vues de
votre 75mm. Cet appareil convient typiquement à la nature morte : faible
profondeur de champ et vue prise de tout près.
Les principes du montage stéréoscopique
Respect absolu de la verticalité
Evitez toute déviation verticale ou toute
rotation (même identique) de chacune des vues. Les points homologues des
2 images du couple doivent se retrouver exactement à la même hauteur
dans le cadre. Les lignes horizontales des 2 images doivent être montées
à l'horizontale et se correspondre.
Evitez toute violation de fenêtre
Le placement de l'image photographiée en
avant ou en arrière du cadre que constituent les montants du cache
dépend de ce que vous écartez ou rapprochez les 2 vues horizontalement à
l'intérieur de leur fenêtre de cadre. Si vous écartez les vues dans
le masque, l'image s'éloigne dans la profondeur du cadre. Si vous
rapprochez les vues, l'image se rapproche de la fenêtre du cadre.
L'image photographiée doit apparaître la
plus près possible du cadre. Mais attention, sauf volonté expresse de
réaliser un "surgissement",
la distance entre 2 points homologues de l'avant-plan le plus proche
doit toujours rester supérieure à la distance entre les deux fenêtres du
cache.
En pratique c'est simple : on regarde le
couple en relief, et on fait glisser latéralement l'une des vues jusqu'à
ce que la fenêtre du masque coïncide avec le premier plan. La fenêtre du
masque doit au final se retrouver légèrement en avant du premier plan de
la vue. Seule exception à cette règle : un élément complètement isolé en
premier plan de l'image peut être porté en avant de la vue de sorte de
réaliser un effet de jaillissement. Ne réalisez de surgissement que sur
un élément d'avant-plan non coupé par le cadre.
Conseil additionnel
Dans la vue de gauche (celle de l'œil
gauche), à l'infini, on doit voir plus d'éléments à droite que dans la
vue de droite.
Réciproquement, dans la vue de droite (celle de l'œil droit), à
l'infini, on doit voir plus d'éléments à gauche que dans la vue de
gauche.
Résumé en image
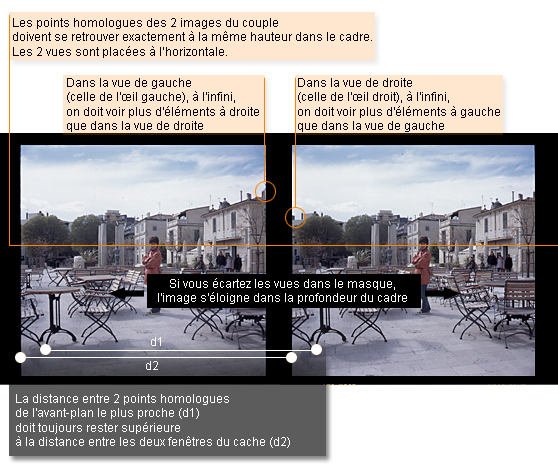
Le montage stéréoscopique en pratique
Dans le cas où la photographie a été prise
avec un seul appareil non stéréoscopique et en 2 étapes, vous êtes en
danger et devez être particulièrement soigneux au montage : vous n'avez
en effet aucune aide vous permettant d'associer rapidement et facilement
2 vues l'une avec l'autre. Si vous faites du 6x13, heureusement,
le format un peu plus grand "rattrape" quelque peu d'éventuelles
imprécisions de montage, mais toujours au détriment du confort visuel.
Donc ne comptez pas trop dessus et essayez d'être précis.
Nous expliquons ici le montage le plus
facile dans le cas où les vues ont été prises avec un appareil à 2
objectifs donnant des photographies contigües (cas des formats 6x13,
45x107 et
Super Duplex).
Nous nous inspirons de la méthode préconisée par
G.Dirian (in La Transposition Automatique des Couples
Stéréoscopiques sur Pellicule) qui nous a semblé la plus claire sur
la question.
L'auteur rappelle que le montage a pour
but :
1. Un parallélisme rigoureux entre toutes les droites joignant 2 points
homologues et l'absence de toute rotation, y compris d'une rotation
identique de deux images (cette condition est totalement remplie si on
photographie avec un appareil sur un rail ou avec un appareil donnant un
couple stéréoscopique, donc on n'insiste pas)
2. Un parallélisme rigoureux entre ces droites et le bord de la monture
(il faut souvent y travailler, même si le respect du niveau à la prise
de vue peut faciliter énormément les choses)
3. Une constance rigoureuse de l'écart entre points homologues images
d'objets situés à l'infini (et non des objets les plus éloignés
visibles). Sur ce dernier point G. Dirian est un peu sur la défensive,
admettant des "dérogations à ce principe qui ne devraient être
qu'exceptionnelles". Si l'on nous a suivi dans la partie précédente, G.
Dirian ne fait rien moins que contester la pratique de l'écartement ou
du rapprochement des vues dans le masque (qui permet d'avancer ou de
reculer l'avant-plan dans le cadre). C'est là une prise de position
"puriste" quant à l'effet-relief, qui devrait rester pour l'auteur le
plus naturel et le plus constant possible.
Ceci amène l'auteur à poser "les principes
d'une transposition automatique d'un couple sur pellicule". Il faut :
a/ "Effectuer la transition des 2 vues parallèlement à une droite
joignant 2 points homologues quelconques (et non parallèlement au bord
du film).
b/ Régler l'écartement des vues en se basant exclusivement sur la
distance entre points homologues à l'infini du couple transposé, après
avoir décidé ce que sera cette distance sur le couple transposé"
Succession des opérations
1/ Création de la base
On place le couple stéréoscopique ABCD -
dont les bords sont ici bien mal coupés aux ciseaux - sur une table
lumineuse. A l'aide d'une règle métallique à bords parallèles et d'un
cutter, on coupe la partie D'C'DC en calant la règle sur deux points M
et N homologues à l'image. (D'C' est donc parallèle à MN). Il est
recommandé de ne pas poser directement la règle sur la diapositive mais
de couper au travers de la protection en cellophane avec laquelle le
film a été livré. Pour éviter tout glissement malencontreux G.Dirian
conseille même de faire sabler la partie de la règle en contact avec la
cellophane.
On remarquera que plus la photographie a
été prise de travers et plus on a une coupe importante sur la vue
stéréoscopique... pensez la prochaine fois à horizontaliser le plus
possible l'appareil photographique au moment de la prise de vue !
Soyez extrêmement scrupuleux et exact à la
découpe; c'est le moment le plus important (et le plus dangereux pour la
vue) de tout le montage.

2/ On doit obtenir ce couple
stéréoscopique "basé" sur lequel on mesure à présent la distance entre
deux points homologues à l'infini Pet Q : cette distance correspond à
l'écartement exact de vos deux objectifs au moment de la prise de vue.
NB. Sur notre vue on n'a pas de point
homologue à l'infini. On s'est contenté de prendre une valeur qui est
très proche, la fenêtre sous le portique étant déjà bien éloignée.

3/ Le couple est ensuite séparé par un
coup de ciseaux EF :

4/ Puis on
inverse les deux vues en fixant la distance entre 2 points
homologues à l'infini à une valeur donnée qui peut être PQ (on aura
l'impression de relief la plus proche de celle captée par l'appareil
photographique) mais qui peut être aussi différente, et fixée par vous
(c'est là que G. Dirian insiste pour que vous preniez celle que vous
voulez mais la laissiez fixe d'une vue à l'autre). La translation des 2
vues doit se faire parallèlement à la base D'C' (une sorte de butée
peut-être utile). En fin d'opération les 2 vues sont scotchées entre
elles ou fixées par tout moyen à votre convenance.
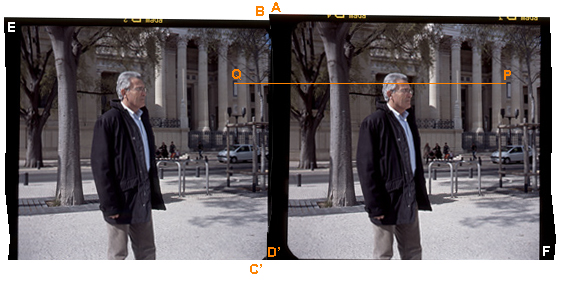
5/ Pour l'automatisation : G.
Dirian suggère la confection d'un gabarit de transposition sur lequel on
peut pratiquer le montage
automatique des vues (c'est à dire un montage fixant définitivement
la valeur donnée à la distance de points homologues à l'infini). Il
conseille la fabrication du gabarit dans une matière plastique rigide
munies de 6 butées cylindriques de 4mm de diamètre, également en matière
plastique, engagées et collées dans des trous réalisés dans la matière
plastique. Il insiste sur la précision nécessaire qui implique le
recours aux services d'un fraiseur.
On a figuré sur le schéma suivant les
butées permettant d'automatiser le positionnement :
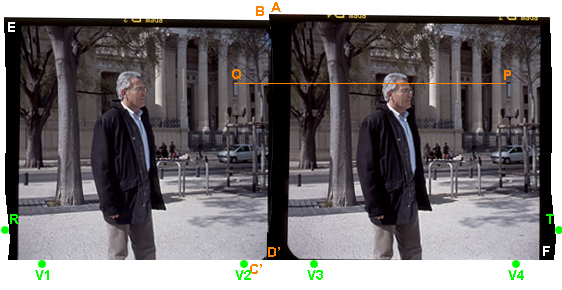
La distance RT sera alors égale à 2 x PQ
si l'on a conservé la distance aux homologues à l'infini
ou à PQ + X si on a choisi X comme distance des homologues à l'infini
après le montage.
6/ Contre l'automatisation :
La Victorian 3D Society, au contraire de G. Dirian, prône un montage
largement piloté à l'œil et à l'aide d'une grille, en conseillant de
faire glisser les vues à l'horizontale pour placer la fenêtre au bon
endroit dans la vue. On y insiste surtout sur la règle selon laquelle la
distance séparant les points homologues les plus proches doit être
toujours supérieure à celle séparant les 2 fenêtres qui vont masquer la
vue. Si cette règle n'est plus respectée, il y a jaillissement. On
peut le faire exprès, encore faut-il que l'objet en jaillissement n'ait
aucun contact avec la fenêtre. Les auteurs déconseillent par ailleurs un
éloignement des points homologues à l'infini supérieur à 63,4mm (cette
valeur étant donnée sans explication dans notre référence).
Dans cette méthode pas seulement
australienne (méthode
2 de Fritz G.Waack), on tâche simplement d'amener le premier plan le
plus près possible du plan de la fenêtre en faisant glisser les vues
dans les masques et en surveillant les opérations avec un stéréoscope.
Une autre méthode classique consiste à
choisir comme valeur de séparation pour les homologues à l'infini la
distance séparant les deux caches (d'après
Fritz
G.Waack, méthode 1). On pourra donc choisir cette valeur comme QP de
montage de la méthode Dirian, puisque G. Dirian reste muet sur le choix
de cette dimension et se réserver la possibilité de jouer sur le
glissement des vues pour jouer d'éventuels surgissement sur certaines.
Ces dernières méthodes peuvent nécessiter
de pouvoir contrôler facilement l'horizontalité des déplacements des
vues. De la même façon si vous ne désirez pas aller jusqu'à la
fabrication d'un gabarit ou ne désirez pas fixer définitivement la
distance des homologues à l'infini, et êtes à la recherche d'un
entre-deux vous facilitant le montage, vous pouvez télécharger ici une
grille qui vous aidera à monter simplement vos couples 6x13 sur la
table lumineuse.
Un mot pour terminer : les manipulations au départ semblent assez
compliquées, et il faut vraiment commencer à pratiquer pour se faire
sa religion et vivre ce que les mots veulent dire. Heureusement le
résultat procure énormément de plaisir. Quand le relief vous saute à
la tête, c'est autre chose et vous êtes instantanément payés de vos
efforts.
Après cette page qui récapitule les méthodes des bons auteurs, vous
pouvez aussi lire, si vous avez l'intention de pratiquer le montage
sous verre, la
page où je montre en image la façon dont je procède pour le
6x13. |

