Thérèse Verrat
et Vincent Toussaint

©Thérèse Verrat et Vincent
Toussaint
Thérèse et Vincent comment en
êtes-vous venus à la photographie ? Thérèse Verrat
:
J’ai d’abord été formée en architecture, puis en
histoire de l’art. À l’époque, je pratiquais la
photographie de manière très intuitive. Sans
doute par manque de connaissance, je me servais
davantage de ses qualités plastiques que de ses
propriétés techniques. Par la suite, j’ai
abandonné l’outil pour collaborer avec des
artistes : je construisais les décors qu’ils
capturaient. Lorsque j’ai rencontré Vincent,
j’ai recommencé à photographier. Assez
naturellement, nous en sommes venus à travailler
ensemble.
Vincent Toussaint :
J’avais 9 ans quand j’ai commencé à
photographier des œuvres d’art dans les musées
parisiens que ma grand-mère m’emmenait visiter.
S’en suivaient des séances de projections dont
je me souviens encore aujourd’hui. Toutes ces
photos ont malheureusement disparu l’an dernier
dans un incendie. J’ai renoué avec la
photographie à la fin de l’adolescence, à
l’occasion d’un voyage, avant d’intégrer l’école
des Gobelins en 2011.

©Thérèse Verrat et Vincent
Toussaint Pourquoi travaillez-vous à deux ?
Pourquoi ne pas travailler à deux quand on
partage autant ? Les gens sont souvent perplexes
face à l’idée du duo en photographie, et dans
l’art en général. Il s’agit pourtant d’une force
: le dialogue est toujours fertile et nous
stimule à chaque étape de nos projets. Pour nous
travailler ensemble est une force, sûrement
celle qu’il nous fallait pour assumer ce choix.

©Thérèse Verrat et Vincent
Toussaint Dans votre travail on sent un goût très fort
pour la courbe. Pourquoi ?
Parce qu’elle mène d’un point à un autre, la
courbe est indissociable de l’idée de mouvement
: se déplacer revient quelque part à tracer une
ligne. Chacune de ces trajectoires nous
permet d’appréhender un territoire, mais
aussi son histoire. La courbe est douce : elle
permet de changer de direction sans former
d’angles. Cet attrait pour la courbe fait par
ailleurs écho à notre goût de la rencontre :
suivre une courbe, c’est se pencher sur quelque-chose d’extérieur à soi. Et par conséquent,
accepter d’être modifié par elle.

©Thérèse Verrat et Vincent
Toussaint On sent également beaucoup de pudeur ou de
retenue, presque de la tendresse ?
C’est très juste. On
pourrait même parler de fragilité : tant sur le
fond que sur la forme, c’est cette tension, ce
point d’équilibre qui nous intéresse. En atteste
notre fascination pour les ruines antiques et
contemporaines, pour les paysages ou plus
largement, pour la nature. Cette réserve est
aussi le fruit du mélange entre soi et l’autre,
de ce langage duel. Comme le dit Virginie Huet,
auteure et critique d’art, notre œil « berce et
brutalise ». Nous portons une attention
particulière à quantité de choses, souvent
ordinaires, qui, vues de plus près, semblent
précieuses. Une sorte de métamorphose qui
rappelle le pouvoir du regard amoureux.

©Thérèse Verrat et Vincent
Toussaint Vos photographies procèdent souvent de moments
qu'on dirait volés. Sont-ils arrachés à l'indifférence générale ou
arrachés au temps ? À l’indifférence générale,
certainement, oui. Au temps, aussi. Depuis
quelques mois, nous travaillions autour de
photographies prises à Naples, d’avril à mai
2022, dans un périmètre réduit. Nous empruntions
chaque matin le même chemin, sans que cette
répétition ne dicte notre démarche. Le temps
n’existait plus en effet, ni le nôtre, ni celui
du sujet.
Quant à cette sensation d’images prises à la
sauvette, elle est probablement liée à cette
timidité, cette forme de réserve que nous
partageons.

©Thérèse Verrat et Vincent
Toussaint Il y a de nombreuses citations à la grande
tradition artistique dans vos travaux. Pourquoi ?
C’est un mot fort, la tradition ! Le simple fait
d’utiliser un outil dans sa forme primitive
(l’appareil argentique) trahit notre volonté de
faire perdurer. Après tout, un artiste est
témoin d’une époque, mais aussi spectateur du
patrimoine édifié par d’autres avant lui. Il
navigue dans le temps et l’espace, et donne à
son tour, grâce à son œuvre, une vision du
monde. On ne peut nier l’influence du contexte :
le terrain vierge n’existe pas. Citer la grande
Histoire de l’art sans la paraphraser est aussi
difficile que d’imaginer y laisser une trace.
Comment admirer le sublime et parvenir à le
restituer de façon personnelle, nouvelle ? Le
mystère reste entier. Toujours est-il que ces
paysages méditerranéens qui nous aimantent, ceux
auxquels notre photographie rend hommage, ne
sont que des champs de ruines, témoins d’une
grandeur passée. Autrefois architectures, elles
s’offrent à nous dans leur fragilité,
très loin de leur splendeur d’origine. Ces
pierres dispersées comme les moutons d’un
troupeau inspirent le respect, et nous inspirent
tout court.

©Thérèse Verrat et Vincent
Toussaint Que représente cette photographie et qu'est-ce
qui vous plait en elle ? C’est
amusant que vous ayez choisi cette image. Elle
nous pose problème depuis quelque temps. Nous en
avions réalisé un tirage à l’occasion d’une
exposition. Or le choix du format était une
erreur. C’est une question décisive, cette forme
que prend la photographie, indépendamment de ce
qu’elle représente, cet objet qu’elle devient au
risque de l’éloigner de son sujet. En
l’occurrence, une table ajourée et l’ombre
qu’elle dessine au sol, dans une maison de
famille. Il s’agit du négatif d’un Polaroid. Un
objet positif/négatif qui, à force d’être trop
inversé, trop manipulé, a fini par nous perdre,
nous lasser. En le retrouvant aujourd’hui, six
ans plus tard, nous lui préférons sa forme
d’origine.
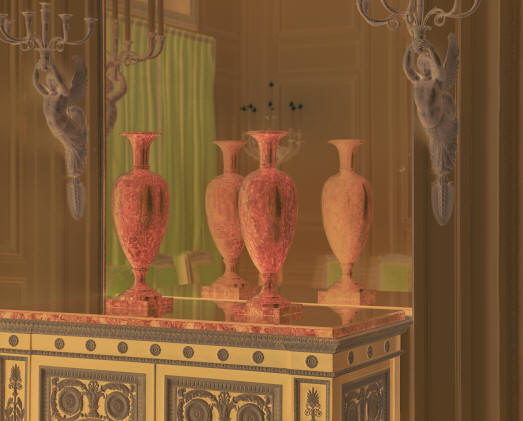
©Thérèse Verrat et Vincent
Toussaint On voit passer souvent dans vos travaux des
négatifs argentiques couleurs comme cette image, présentés à côté de
positifs "normaux". Pourquoi ce choix ?
La découverte du négatif sur la table lumineuse
a quelque-chose de magique,
d’hypnotique. Dans certains cas, cette
expérience suffit. Formes, volumes et motifs se
devinent à travers un voile quasi abstrait. Une
abstraction qui peut même
dépasser le réel. Parfois, il nous semble
pertinent de s’arrêter là, à ce stade
préliminaire. La cohabitation avec l’image
finale questionne la matière
photographique, comme une preuve tangible du
processus de développement.

©Thérèse Verrat et Vincent
Toussaint Qu'est-ce pour vous qu'une belle photographie ?
Une image sincère, capable
d’émouvoir au point de rester en mémoire. Une
belle photographie raconte une histoire. Elle
est une fenêtre ouverte sur le monde visible et
son envers, ce qui dépasse l’entendement.
|

