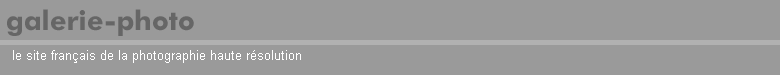


l'Auteur
|
Henri Peyre
|
Y a-t-il une Esthétique de
la Photographie de bateau ?
par Henri PEYRE
Introduction
Cet article pose une question dont je ne doute pas que l'humanité entière attend depuis longtemps la réponse : "y a-t-il une esthétique de la photographie de bateau ?", et j'aurais pu préciser même de "bateau de commerce" tant le goût de l'esthétique photographique et la passion de cette sorte de bateau me travaillent ensemble et depuis longtemps. Je pense que l'être humain est cohérent et que tenter de répondre à cette question est finalement du plus grand sérieux, au moins en ce qui me concerne, et relève à la fois de l'urgence et de la plus grande nécessité. On trouvera dans cet article un certain nombre d'exemples d'images soit recueillies sur ebay, photographies abandonnées dont j'espère que certains d'entre- vous les adopterons - soit venant de la liste marmar(2), groupe de discussion Yahoo spécialisé sur le thème de la Marine Marchande. Elles permettent d'entrer avec la légèreté et la clarté de l'exemple dans le domaine de l'esthétique où pas mal de gens ont fait naufrage, et pas que des marins d'eau douce (je compte dans le nombre Platon ou Kant qui ont envoyé par le fond, à leur suite, des générations de lecteurs).
Y a-t-il une esthétique
de la photographie de bateau ?
La recherche artistique consiste le plus souvent à mettre en scène des zones-frontière. Bien analyser l'esthétique des images revient de ce fait à repérer dans les images les ensembles cohérents et opposables qui y sont présents et à examiner la façon dont ils s'articulent. Il y a des images à faible niveau esthétique : souvent confuses, elles n'offrent pas la clarté d'opposition facilement décelable. Il y a des images à très fort contenu esthétique : on y repère non pas seulement une opposition (qui fait déjà souvent la belle image) mais deux, trois oppositions ou plus, clairement indiquées par le photographe. Plus il y a d'oppositions décelables en jeu, plus l'image apparaît riche au spectateur et capte longtemps l'attention(1).
La photographie de bateau présente dès l'abord et tout à fait naturellement une grande puissance esthétique : le bateau en marche est, par essence, un objet offrant des limites parfaitement définies et l'observateur opposera bien facilement le sujet "bateau" à son environnement (1ère opposition). D'où un choc esthétique immédiat et violent lorsque le bateau est ainsi présenté dans sa pure essence :

Bateau vapeur Vitznau Suisse - ebay-181653237703
Dans la photographie ci-dessus cet aspect est renforcé par la stricte observation des règles qui font qu'une photographie marche à tous les coups : un sujet centré, qui porte les contrastes les plus forts, meilleur noir contre meilleur blanc, tandis que l'environnement autour du bateau offre des contrastes beaucoup plus faibles (2ème opposition). La lumière dans le dos permet au ciel d'être moins lumineux que le blanc de la coque du bateau et referme l'image autour du sujet principal, comme le disent les tireurs. Opposition réussie, donc, entre le sujet et son environnement.
Le contraste objet artificiel contre environnement naturel, troisième élément constitutif de la forte esthétique de cette image (et 3ème opposition), termine d'en faire une image qui marche très bien. On peut affirmer qu'un bateau en mer est tout naturellement un objet à fort contenu esthétique, avec ses 3 oppositions facilement repérables.
Lorsque le bateau est présenté dans un environnement fort et complexe, son impact esthétique peut-être toutefois très différent et l'esthétique de l'image n'est pas à ce moment autant attribuable à l'objet lui-même. Un exemple avec une nouvelle image.
 Notre-dame
de la Salute - Venise - ebay-264207268588
Notre-dame
de la Salute - Venise - ebay-264207268588
Cette image est une belle image, qui retient
l'attention. Mais pourquoi, quelles sont les
oppositions à l'œuvre ?
Le sujet, qu'on met au centre, est une gondole.
L'œil rentre dans l'image par le contraste
principal, qui est celui du noir de la gondole
opposé au blanc de l'écume sous elle. Après la
lecture de cette opposition l'œil ressent un
deuxième contraste : il élargit l'opposition au
contraste clarté du ciel / noir de la gondole :
on ressent violemment l'effet de contre-jour.
Cet effet de contre-jour suspend la gondole dans la lumière. Elle ne
reste attachée que par le gondolier aux valeurs
sombres de la rive. On perçoit donc que, n'était
le gondolier qui la maintient, la gondole se
détacherait complètement de l'environnement pour
flotter à sa guise.
La réalité du sujet apporte
des éléments concrets à l'analyse esthétique :
l'écume sous la gondole vient des remous de
propulsion du vaporetto sur lequel est
probablement le photographe. Les remous
fragilisent la tenue de la gondole que le
gondolier, attaché à la rive comme à l'ordre du
monde, tente de maintenir. Mais l'horizon
penché, comme l'effondrement des immeubles sur
la gauche, portent dans la vision même du
spectateur la fragilité de la position de
l'esquif.
L'image marche parfaitement parce
qu'on retrouve dans le flottement spatial de la
gondole en contre-jour comme dans la position
des éléments réels une même idée : celle de
l'esquif fragile, emporté par les flots, qui
devient le symbole de l'esprit d'un observateur
lui-même balancé vers la gauche, et éprouvant en
lui-même la légèreté symbolique de la gondole
comme légèreté de sa propre situation. On est
certes à Venise, sujet intéressant en soi, mais
on peut parler de cette circonstance en tout
dernier cependant, tant le sujet est plus cette
idée de légèreté et de détachement que le frêle
et élégant esquif inspire. A la fin, oui,
peut-être pourra-t-on juste ajouter : "et c'est
là le charme de Venise". Mais à la fin
seulement, pas avant.

bateau de transport en mer - ebay-312015981642
On retrouve dans cette image, comme dans la
première, la présence
du bateau comme élément opposable à son
environnement. Mais il y a là une nouveauté,
constituée par cette poulie de premier plan, qui
s'invite comme meilleur contraste blanc/noir. Il
y a ainsi concurrence dans cette image, pour le
regard, entre le bateau au centre, sujet
principal, par lequel on rentre, et cette poulie
de premier plan sur son bras blanc qui aspire
le regard juste après.
Cette disposition a plusieurs conséquences : le
spectateur est invité à évaluer tout de suite la
distance entre le bras de poulie et le bateau,
et, arrivé au bateau, à prolonger ce regard
traversant vers l'autre rive. Après ce parcours, qui donne une information de
surface, le cerveau réalise que l'image est
penchée et que le bateau "descend" ce qui a
l'air d'être une rivière ; de plus il assimile le
bras et la poulie à une rive d'où
nous regardons la scène, à cause du fait que
nous voyons en face une autre rive (alors que
nous sommes peut-être en fait sur un bateau).
Comme dans
l'image précédente, le fait que l'horizon penche
a fragilisé quelque-chose. Mais ce n'est pas
notre position personnelle qui est fragilisée.
C'est celle du bateau, engagée sur une pente
savonneuse, qui est affaiblie, d'où notre
première certitude, renforcée (quoique
probablement fausse), que nous sommes sur une
autre rive, et que le bateau est emporté.
Son effet principal, qui est réussi, est
l'évocation d'une très grande coulée d'eau qui
glisse vers la droite d'une seule masse,
entraînant avec elle le petit bouledogue.
L'image est belle dans la façon dont elle parle
de l'abandon à l'immensité du flot.
Ce n'est pas tant une photographie de bateau
qu'une photographie d'eau. Son effet esthétique
vient de l'opposition que nous percevons entre
notre position (faussement considérée comme
fixe) et la coulée inexorable de l'immensité de
la masse d'eau vers la gauche.
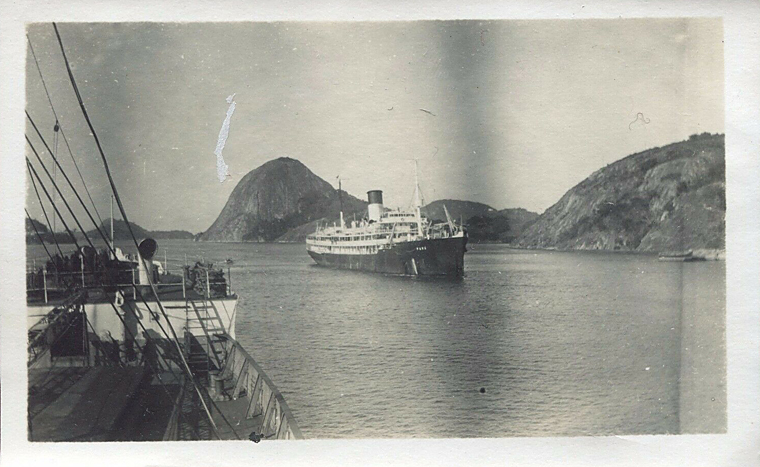
Vittoria Bresil (1926) - ebay-391764136030
Cette photographie n'est pas celle d'un bateau
isolé. Le bateau n'y est donc pas, quoique placé
au centre, le sujet principal. Le meilleur
contraste est porté ici par les oppositions de
blanc et de noir sur le pont du bateau de gauche
d'où, certainement, la photographie est prise. On
ne peut pas dire non plus que la photographie
illustre les périples du bateau sur lequel nous
sommes. L'autre bateau est trop central et se
bat fort bien pour conserver notre attention.
Comme dans la photographie précédente (celle
avec la poulie), le bateau sur lequel nous
sommes permet l'évocation d'un premier plan,
donc invite à la perception de la distance
entre notre position et celle du bateau au
centre de l'image. Cette traversée diagonale de
l'image se poursuit fatalement jusqu'au lointain
droit de l'image, avant que l'œil ne vienne
explorer enfin le lointain gauche de l'image,
d'où vient le paquebot. Comme l'horizon est
rigoureusement horizontal, nous ne sommes pas
invités à considérer la masse d'eau. Le cadre
général de l'image et la présence exotique des
collines en pain de sucre nous invitent au
dépaysement. Ce dépaysement est renforcé par les
nombreuses traces et salissures de cette image
déjà très ancienne, qui nous conduisent, elles, à un
dépaysement temporel. L'effet esthétique de cet
image tient donc à la conjonction de deux
oppositions : celle entre notre monde et celui
évoqué par ce lointain géographique. Celle entre
notre temps et celui évoqué par cette vieille
image. Dans les deux cas ces oppositions ne sont
pas consubstantiel à l'image. C'est une
opposition entre ce que nous voyons et ce que
nous sommes. Entre des éléments réels et notre
cadre interprétatif. Cela marche comme l'urinoir
de Duchamp : je ne suis épaté que parce que
j'attendais un chef-d'œuvre et pas un urinoir
au musée. La puissance esthétique est toujours
très menacée quand elle ne réside pas à
l'intérieur de l'œuvre mais s'appuie sur les
fondamentaux supposés de celui qui la regarde.
Sur cette image, un Brésilien ne sera pas
dépaysé par les pains de sucre, et je suppose
que dans les années trente, l'ancienneté de
l'image n'aurait frappé personne... Je ne pense
pas, pour ma part, qu'une proposition qui ne
présente pas les oppositions au sein d'elle-même puisse
être une œuvre d'art.
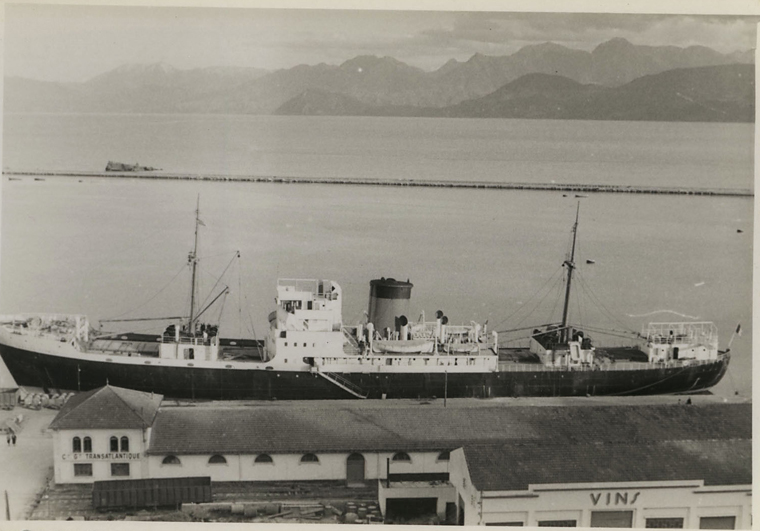
Cargo CGT - ebay-183185001127
La composition de la scène est également faite d'une série de bandes horizontales qui coupent la scène et enferment le navire :
- les entrepôts en bas,
- le cargo et une première étendue d'eau,
- une digue avec une conjonction désagréable des hauts du mât du bateau et des pierres de la jetée, qui cloisonnent encore l'image,
- un espace d'eau avec ce qui pourrait bien être une épave,
- des montagnes assez grandioses mais malgré tout bien inhospitalières.
Après cet examen un peu décourageant, le regard revient au premier plan et se porte sur le mot "Vins" plus lisible que la mention "Cie Ge Transatlantique". L'interprétation est toute mâchée : nous avons là une image qui est tellement triste qu'elle semble avoir un sens politique : la Colonie serait un système implacable dont l'image trahit un des ressorts, l'alcool.
La seule esthétique qu'on pourrait concéder à cette image serait de considérer qu'elle présente une sorte d'échelle de liberté, allant du premier au dernier plan,
- la petite magouille commerciale coloniale, au premier plan ;
- le bateau, qui représenterait la parenthèse possible ou le moyen de s'échapper ;
- au dernier plan la mer et les montagnes, suggestions de la beauté encore possible au-delà des petits trafics.
D'expérience, quand on doit tant ramer pour trouver une beauté qui n'est pas bonne fille, il vaut mieux passer à l'image suivante.

Bateau et berge - ebay-312014617969
Cette image aurait très certainement plu à
Marguerite Duras. Le meilleur contraste est sur
le bateau au premier plan, instantanément épaulé
par le contraste au lointain. La succession
quasi immédiate des perceptions nous donne
instantanément l'impression que le bateau est en
route vers le lointain et je suis prêt à parier
qu'aucun d'entre-vous ne se sera dit qu'on voit
l'arrière du bateau (ce qui est malgré tout
possible). L'organisation de l'image conduit
ainsi, comme pour l'image à la poulie, à une
certaine interprétation, même si celle-ci est
peut-être fausse.
Cette image est esthétique pour une raison très
intéressante. Si le bateau a l'air très
déterminé à aller quelque part, ce quelque-part n'a pas l'air très folichon : quelques
vagues arbres, sur quelques vagues collines
croupions achèvent de se baigner dans une eau
bien plate. L'image nous renvoie ainsi à une
intériorité très durassienne : la fascination de
l'attente. A la fois on attend et à la fois on
est déçu. On va quelque part, mais on ne va nulle-part. L'horizon discrètement incliné vers la
gauche suggère que la destination
serait plus à droite (écoulement de l'eau), et
que l'observateur pourrait être lui-même
vaguement désemparé, comme dans l'image de la
gondole. Joue évidemment aussi dans cette image,
comme dans toutes les images de bateau, le fait
que le bateau est un élément juste placé entre
ciel et mer, position charnière naturellement
intéressante, renforcée ici par l'idée du
confins des terres qui donne tant de charme
naturel aux rivages (raison esthétique pour
laquelle, je présume, les retraités rêvent tous
de terminer leurs jours au bord de la mer).

Bateau croisiere île de beauté - ebay-183270431176
Dans cette image on retrouve des éléments déjà
vus : l'horizon penché vers la gauche fait
psychologiquement glisser la masse d'eau vers la
gauche, dans un sens qui accompagne l'avance du
bateau. Le spectateur a ainsi l'impression que
le bateau avance facilement. Le rivage
fonctionne au contraire : on rentre sur le
rivage par l'enfant à gauche et l'œil parcourt la plage en remontant vers
la droite. Le chemin remontant demande un peu
d'effort ; le bateau n'en glisse que plus
rapidement vers la gauche.
La facilité du déplacement du bateau invite à
penser la scène comme très silencieuse, puisque
le bateau n'a qu'à se laisser glisser. Les
personnages sont séparés les uns des autres et
donc muets. Le bateau, forme dense et ramassée,
s'oppose à ces petits individus disséminés sur
la plage. Il est le symbole d'un
regroupement, tandis que les laissés-à-terre
symboliseraient une sorte de division. Le bateau
pourrait ainsi apparaître comme une promesse (au
moins celle du voyage) à laquelle les mornes
silhouettes du premier plan, méditant leur
malheur, n'ont pas été conviées. Plusieurs
oppositions donc, en tirant un peu : facilité de
la progression du bateau en descente contre
rivage à remonter, bateau comme collectif
d'avenir et en action contre personnages
disséminés et mornes : l'horizon peu
discernable du ciel, évoque une fusion en
devenir. Le bateau va y disparaître. A mi-chemin,
entre le rivage où les hommes sont chacun isolés
et un lointain où tout fusionne, il apparaît de
ce fait comme un collectif en marche.

Marine chinoise - ebay-333091664488
Dans cette image
ancienne, on entre par la menace noire et
préoccupante de la partie gauche de l'image. Le
danger nous fait peur et nous avons tendance à
fouiller dans le noir le meilleur contraste du
blanc et des deux canons sombres, avant de
suivre naturellement la silhouette du cuirassé
vers la droite pour arriver dans la lumière, où nous attend le
second point d'arrêt à fort contraste : la
jonque.
Le basculement de la mer, à cause de l'horizon
penché à droite, nous a dès l'abord inquiété au
point qu'il nous fallait fouiller l'obscurité.
Toute la masse d'eau dévale la pente naturelle
vers la droite, qui aspire tous les éléments de
l'image, jonque comprise. Le flou des flots au
premier plan accentue le malaise de ce grand
déversement, refusant à notre œil un premier
plan, et donc l'appui fixe d'une rive (comme
dans la photographie du bouledogue).
Même si nous avons l'impression que la jonque
travaille à remonter la pente vers la gauche,
nous avons bien le sentiment que cela ne sera
pas suffisant. Rien n'arrêtera la marche vers la
guerre et le jour à gauche est plutôt la fin
d'un espoir que la promesse d'un temps meilleur
: les fumées du navire ne contribuent-elles pas
à rendre les nuages plus épais ?
Cette image n'offre pas, en son sein, de
contraste esthétique. Si elle est malgré tout
une belle image, c'est là encore parce qu'elle
s'oppose de toutes ses forces, par sa folie, par
son basculement insupportable à ce que devrait
être une image "normale" : par ce bateau de
guerre, par ce contre-jour inquiétant, par ce
flou de premier-plan, par cet horizon
complètement basculé. S'il y a esthétique
elle est
uniquement fondée sur notre capacité à opposer
d'instinct cette image à une normalité
personnelle où il n'y a ni bateau de guerre, ni
contre-jour inquiétant, ni horizon basculé.
S'y ajoutent évidemment, suivant le même
mécanisme, le dépaysement de temps et le
dépaysement d'espace, pour un européen qui ne
voit pas de jonque tous les jours.
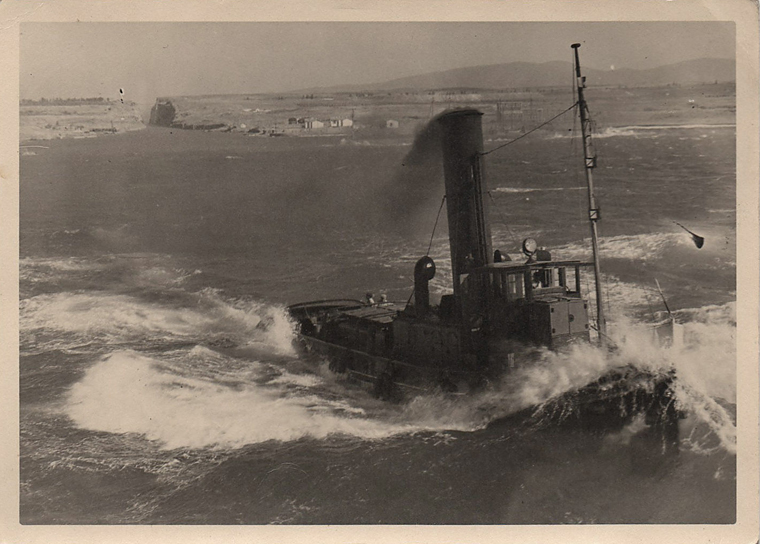
Remorqueur - ebay-201678562447
Cette très belle
image de remorqueur, probablement prise au
débouché du canal de Corinthe, semble raconter
une petite histoire. Le spectateur voit fort
bien d'où vient le courageux remorqueur. Le
trajet nettement lisible et compréhensible
s'oppose comme volonté logique et opiniâtre à
la violence désorganisée des flots.
Esthétiquement on trouve en outre dans l'image
la classique opposition du petit bateau
courageux affrontant les éléments déchaînés,
renforcée ici par l'opposition du bâtiment noir
et de sa fumée noire à l'écume blanche de la mer
en furie.

Vague sur la mer - ebay-232480520229
Cette image de bateau
pris dans une tempête, avec son horizon
psychologique basculé qui renforce l'inquiétude,
reprend les mêmes codes esthétiques classiques
du petit bateau opposé à la puissance de la mer.
A gauche, le flou accentue encore la folie de
l'élément liquide tandis que les filins
parfaitement dessinés, noirs, raides et nets à
droite de l'image, opposent leur opiniâtreté à la démente.
Le sujet principal est la levée d'une vague
monstrueuse, centrée et claire sur un fond sombre.
La double opposition de la violence de la mer
contre la petitesse du bateau ainsi que du
chaos
liquide contre la géométrie du bateau crée
l'esthétique de cette belle image au sujet
renforcé par un fort vignettage.
Examinons à présent quelques images plus
récentes obtenues grâce au site marmar(2),dont
nous saluons la gentillesse des membres et la
courtoisie de son capitaine.
 Royal
Clipper_- Fort-de-France - 7 février 2014
©Yvon Perchoc
Royal
Clipper_- Fort-de-France - 7 février 2014
©Yvon Perchoc
Cette image d'Yvon Perchoc joue sur les éléments
déjà signalés en tout début d'article : le sujet
est placé au centre de l'image, porte le
meilleur blanc et le meilleur noir. Le bateau
détaillé et net s'oppose à un alentour rejeté à
distance, plus flou et plus sombre. Yvon joue à
100% la qualité des bateaux d'être des sujets
naturellement photogéniques. Il y a beaucoup de
chose à voir dans l'image : la mer est bien
détaillée, il y a vaguelettes et écume, les
lointains sont riches et détaillés, le ciel est
complexe et intéressant ; ces trois complexités
répondent à la complexité du bateau, un cinq
mats rutilant saisi dans une vue simple et
directe... un parti de composition biblique,
ici en opposition avec le contenu fouillé de l'image.
 CMA
CGM Christophe Colomb - ©CMA
CGM
CMA
CGM Christophe Colomb - ©CMA
CGM
Dans cette image "officielle" de la CMA-CGM sur
l'un de ses plus grands bateaux actuellement en
service, le point de vue élevé au niveau de la
passerelle a simplifié la mer, rejetée à
distance, qui ne détourne pas le regard de
l'objet bateau, centré en plein au milieu de
l'image. Le ciel plutôt dégagé et aux tendres
reflets roses est lui aussi d'une grande
douceur. L'ensemble du contexte laisse toute sa
place à la force tranquille du bateau dont le
sillage montre qu'il vient de très loin et que
rien ne peut entraver sa marche. La photo est
somptueuse et le message passe parfaitement. La photographie, manifestement venue d'une prise
aérienne, permet d'éviter la présence en bas
d'un sillage parasite, dû à la propulsion de l'éventuel
bateau du photographe.
La passerelle blanche, bien placée au milieu de
l'image concentre le regard du spectateur. Elle
domine légèrement le point de vue
: le bateau nous domine, mais sans trop
en faire. Nous sommes ici bien loin du petit
bateau face à la mer furieuse. Le bateau est un
géant sur une mer grandiose et sous un ciel
immense, un géant parmi les géants.
S'il y a une esthétique ici, c'est celle de la
retenue : le géant de la mer est photographié
tout en douceur. Il convainc que tout est
parfaitement normal et que sa puissance est
parfaitement naturelle et adaptée. On attendrait
un grandiose de circonstance et rien ne vient.
Tout est naturel. La seule esthétique en
opération est la photogénie naturelle du bateau
centré portant le meilleur blanc et le meilleur
noir...
Nous touchons avec cette image un autre point
fondamental. Nous avions déjà fait remarquer en
début d'article que le bateau était un bon sujet
en ce sens qu'il présentait les limites claires
d'un objet parfaitement défini, facilement
opposable à l'environnement homogène dans lequel
il circule : la mer.
Il faut ajouter à ces qualités intrinsèques,
pour les navires marchands, en général de grande
taille, un aspect fondamental : le bateau est un
sujet qui offre
de belles opportunités de comparaison
d'échelle.
Si la photographie précédente montre en effet un
géant parmi les géants, le bateau en mer est
très souvent un nain perdu dans des forces
infiniment supérieures à lui. Lorsqu'il revient
du monde des géants et entre au port, en ce qu'il
est taillé grand pour résister aux puissances de
la mer, il devient un géant. Ce jeu sur les
échelles modifie rapidement les points de vue
sur le navire marchand, et la modification de
ces points de vue est à la base de la jouissance
esthétique. Lorsque le bateau est au port, les
métaphores de Gulliver à Lilliput deviennent
fréquentes et fournissent de formidables images.
Quelques exemples :
 Emma
Maersk -
©Hervé COZANET(3)
Emma
Maersk -
©Hervé COZANET(3)
http://www.marine-marchande.net/groupe%20mar-mar/groupe%20mar-mar.htm
Dans cette très belle photo où le bleu des
coques de chez Maersk se compare au bleu du
ciel, l'étrave du grand corps du géant, juste
retenu par les liens des lilliputiens domine
l'observateur de très haut. Le navire marchand
appartient manifestement au monde des géants et
le point de vue permet d'en admirer la puissance
et la force. La rouille sur le bulbe renvoie aux
matériaux primitifs et ajoute de la puissance à
la puissance. Un grand classique, parfaitement
réussi. L'opposition entre notre monde
(de nain)
et celui du bateau (le géant) passe ici en-dehors de l'image.
Il n'y a évidemment qu'une opposition et
encore, extérieure à l'image, mais tellement forte et claire que
l'image est fort belle.
 Peinture
sur la coque -
©Hervé COZANET
Peinture
sur la coque -
©Hervé COZANET
http://www.marine-marchande.net/groupe%20mar-mar/groupe%20mar-mar.htm
Deuxième image évoquant un message comparable ;
des fourmis aident le géant, cette fois juste
suggéré. On retrouve ici, avec les peintres,
l'opposition des nains et des géants mais
intégrée à l'image, ce qui est mieux. L'image
est peut-être plus riche également avec
l'apparition d'une deuxième opposition (à peine
suggérée dans la précédente) : on voit la cale
sèche où le monstre est retenu, et au loin, en
bleu délavé, le monde de lumière, auquel le
monstre appartient et auquel il sera rendu,
après le travail dans la pénombre de la cale.
Ombre et lumière, prison et
liberté, cette
opposition est soulignée par la multitude des
liens qui attachent le navire au bord de la
cale.
Il existe enfin une troisième opposition celle
du vide de la cale au plein de la mer : le point
de vue légèrement suggéré au-dessus de la cale
permet de ressentir que la scène a lieu sous
l'eau. Cela introduit une précarité dans
l'action : on sent que la mer pèse pour revenir
et envahir la cale. La situation des deux
personnages, déjà vertigineuse, est donc rendue
encore plus précaire. Si l'on examine enfin de
près l'action dans la nacelle, on a l'impression
que les deux personnages ne peuvent détacher
leur regard du monstre ; presque le jet de
peinture deviendrait une arme qui tient le géant
à distance tandis que le personnage de gauche
semble reculer de peur.
Esthétiquement voilà donc une image qui marche
bien.
 Port
de Rotterdam -
©Françoise MASSARD (4)
Port
de Rotterdam -
©Françoise MASSARD (4)
Cette photographie
pourrait rappeler certaines photographies de
l'art contemporain. Il semble qu'on y expose
l'absence de sujet : pas d'action en route, pas
de photographie de bateau en totalité (de bateau
comme sujet), un calme des éléments qui les
prive de tout romantisme, ciel plat et eau de
bassin lisse, à peine troublée par un léger
clapotis. La circulation du regard ne renseigne
pas plus : il entre par le meilleur contraste,
au premier-plan à droite du gouvernail sous le
bleu sombre de la coque, pour sauter ensuite
sur les grues du Turandot et son mât avant qui
se confondent presque avec les grues du port.
L'œil erre sans but dans le port à l'arrêt. Mais
ceux qui se sont perdus dans les ports, ces
grands espaces qui de temps en temps s'animent,
ceux qui ont communié avec les grands bateaux de
commerce, secoués par les flots, ceux qui ont
longtemps bourlingué dans ces usines flottantes
sous la pression continue des moteurs et le
sifflement des équipements de bord apprécieront,
comme nos géants, le repos de ces havres
hospitaliers où il peuvent enfin goûter au
calme. Le croisement des deux chaines
d'amarrage, à peu près au centre de l'image,
comme un signe qui n'insiste pas et ne cherche
pas à indiquer plus que la possibilité d'un
sens, ne trouble même pas cette image
parfaitement vide où l'on pourra, du coup,
projeter tout l'amour qu'on a de la mer et des
navires marchands.
Cette image, comme nombre
d'images de la photographie contemporaine,
impose son sens contemplatif par la suggestion
d'un cadre. Par le cadrage, le photographe dit
au spectateur qu'il y a un sens à trouver, et le
spectateur est convoqué à parcourir les éléments
donnés pour trouver ce sens. En s'investissant
dans une image expressément vidée de contenu, il
construit lui-même le sens qui lui correspond le
plus ; ce faisant il se projette dans l'image,
s'y reconnait, et finit par lui trouver une
beauté suave.
L'art contemporain joue ainsi de la
participation du spectateur à la construction de
l'œuvre d'art. Elle joue plus comme un piège
pour des spectateurs à l'imagination féconde
qu'elle ne propose dans l'image des oppositions
objectives pour conduire l'interprétation vers
des buts précis et contrôlés par le photographe.
Elle n'en est pas moins extrêmement dirigiste :
toute la violence est reportée sur l'arbitraire
du cadrage, tandis que dans les photographies
d'oppositions maîtrisées le photographe tente de
convaincre le spectateur d'une façon logique. On
retrouve deux approches de l'esthétique : l'une,
sensuelle, impose le périmètre d'une surface de
projection et n'intervient pas sur le film,
l'autre argumente, démontre et veut conduire
avec maîtrise à un effet donné.
Notes
(1) Concernant la
constitution de l'esthétique et les oppositions
on pourra se reporter à ces pages :
www.galerie-photo.com/esthetique-jouissance-beau-comique.html
www.galerie-photo.com/robert-musil-esthetique.html
www.galerie-photo.com/oeuvre-art.html
(2) http://www.marine-marchande.net/groupe%20mar-mar/groupe%20mar-mar.htm : marmar est le groupe de discussions yahoo spécialisé sur la marine marchande associé au site www.marine-marchande.net.
(3) Hervé Cozanet est le capitaine de la liste Marmar et le webmestre de www.marine-marchande.net
(4) Françoise Massard,
ex-seconde capitaine de
www.marine-marchande.net s'occupe du sitehttp://www.cargos-paquebots.net
Dernière mise à jour : mars 2019
|
tous les textes
sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs |
|||||
|
|
|||||
|
une réalisation phonem |
|
||||
|
|
|||||


