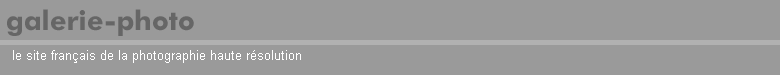|
|
|||||||||||||||||||||||||||

l'auteur
Ce texte de Louise Merzeau
|
Papiers sensiblesPar Louise Merzeau
Argent, platine ou charbon… Chiffon, velours ou satin… L'histoire des papiers photographiques est une histoire de sels et de textures, écrite par des chimistes qui se seraient faits grand couturiers. Ici, l'image se dit en mots tactiles et organiques, parce qu'elle se couche sur un support dont elle épouse les propriétés. Plombée ou aérienne, l'image est prise dans le baryte, l'halogénure, la gélatine. Elle fait des gammes avec les gris, les grades et les grains. Elle a de l'épaisseur et elle vieillit. Ici, la photographie ne fige pas le temps : elle fait l'épreuve du temps. Baignée, insolée, oxydée, réagissant à tous les corps qui la touchent ou l'enveloppent, l'image-papier travaille. Et c'est par le trouble nocturne de sa matière que le visible advient, se défigure ou se souvient. Papier, contre métal et verreDès sa naissance, la photographie se partage entre métal et papier, comme entre lumière et obscurité. Niépce et Daguerre obtiennent des images positives sur des plaques d'étain, de cuivre ou d'argent. Talbot, lui, fabrique des négatifs avec du papier à lettres. Il lave les feuilles au pinceau dans une solution de nitrate d'argent, les sèche, les trempe dans de l'iodure de potassium, puis les lave et les sèche de nouveau. Il dépose ensuite une plante ou une dentelle sur l'une de ces feuilles, et l'expose à la lumière. Après plus d'une heure, le sel noircit et laisse apparaître en réserve une image inversée du corps posé sur le papier. Encore sensible, le nitrate non impressionné est alors éliminé dans un bain de fixage, qui retient pour un temps le noircissement de la surface. En 1839, Talbot augmente la sensibilité de son papier à lettres en le plongeant dans du gallo-nitrate d'argent, avant de l'exposer humide entre deux plaques de verre dans une chambre noire. Au bout de quelques minutes, la feuille est encore vierge de toute empreinte visible, mais l'image latente se révèle lorsqu'on la plonge dans une solution identique à celle de la sensibilisation. Au dessin photogénique, succède ainsi le calotype, qui donne au support-papier une longueur d'avance sur son concurrent de cuivre argenté en ouvrant la voie de la reproductibilité. Car la surface miroitante du daguerréotype est condamnée au régime de l'image unique, quand plusieurs épreuves peuvent être tirées à partir d'un même talbotype, par une opération de noircissement direct. Exposé en contact avec une feuille de papier photosensible dans un châssis-presse, le négatif sert à sélectionner les plages à insoler, comme les fougères des premiers dessins photogéniques. Outre ses capacités de duplication, le papier servant à réaliser les calotypes se conserve assez bien à l'abri de l'air et de la poussière, et il a l'avantage d'être peu encombrant. Il est donc plus facile à manipuler et à archiver que les plaques de métal ou de verre, qui doivent être émulsionnées juste avant la prise de vue. Certes, les premiers talbotypes présentent encore la difficulté de devoir être exposés humides ; mais les négatifs albuminés ou cirés, respectivement mis au point par Blanquart-Evrard et Le Gray vers 1850, suppriment cet inconvénient, et font du calotype le support privilégié des voyageurs, des architectes et des archéologues. C'est l'époque de la Mission Héliographique et de Baldus, de Flaubert et de Maxime Du Camp : légère comme une feuille de papier, la photographie part à la conquête du monde, pour explorer l'Orient ou dresser un inventaire visuel du territoire français. Quant à l'aspect des images produites par ce procédé, qu'elles soient contaminées par le grain du support n'affecte qu'en partie son essor. Car la texture "crayonnée" du calotype lui confère une noblesse et une sensualité, dont on déplore souvent la perte dans les premières images mécaniques que sont les daguerréotypes. En 1847, alors que le verre albuminé parvient à rivaliser avec la finesse du métal, en conservant l'atout de la reproductibilité, Blanquart-Evrard préfère encore le support-papier, parce qu'il produit des " images où l'on trouve plus de suavité ". Parmi les calotypistes - où figuent beaucoup de peintres convertis -, nombreux sont ceux qui travailleront cette granulosité pour en tirer certaines ressources plastiques ou expressives, propres à fonder une nouvelle esthétique photographique. Talbot, Bayard, Hill et Adamson, Le Secq ou Nègre font ainsi parler le papier, en jouant des effets de sfumato, des clairs-obscurs et des contrastes entre matières. Si sa texture est appréciée, on déplore néanmoins le flou causé par l'opacité du négatif-papier. Gustave Le Gray propose alors de l'enduire avant sa sensibilisation d'une couche de cire d'abeille pour en boucher les pores. Le négatif étant ainsi plus translucide, la finesse des tirages s'en trouve améliorée, sans perdre pour autant son étoffe particulière. Mais plus qu'un certain rendu de l'image, on attend surtout de la photographie qu'elle garantisse une exactitude : dans la définition des traits, dans la standardisation des procédés comme dans la rapidité des prises de vue. Vers 1855, le papier doit donc céder sa place au verre enduit de collodion, humide mais plus transparent, plus fiable et plus sensible. A partir de 1871, les émulsions au gélatino-bromure d'argent, encore plus rapides, remplacent le collodion et sont commercialisées sous forme de plaques sèches, prêtes à l'emploi. La gélatine pouvant aussi s'appliquer sur du papier, celui-ci revient alors sur le marché des négatifs, avec le film en rouleaux de George Eastman, qui invente la première machine à émulsionner. L'American Stripping Film, intégré à partir de 1888 au premier appareil Kodak, permet de réaliser une centaine de vues sans avoir à s'encombrer de plaques ni même de laboratoire, puisqu'il est vendu avec le service de développement et de tirage : " You press the button, we do the rest…" Toutefois, ce sursaut du négatif papier sera rapidement stoppé par l'apparition d'une nouvelle matière, le celluloïd, qui le remplace à partir de 1889 dans les appareils Kodak. Il ne reste plus qu'à protéger les bobines de pellicules par du papier noir, pour que l'opérateur puisse lui-même charger et décharger son appareil. Après qu'Eastman ait acheté le brevet de ce procédé en 1894, l'essor de sa firme et de la photographie amateur ne connaissent plus d'obstacle… et le papier cesse définitivement d'être un support de prise de vue. Du papier esthète au papier marketingS'il perd la bataille des négatifs, le papier s'impose en revanche comme support privilégié des images positives. Le procédé utilisé pour le tirage des calotypes et des plaques au collodion est encore très instable. Réalisé avec du papier à lettres ou à dessin lavé au sel marin puis sensibilisé au nitrate d'argent, il produit des épreuves où l'image, contenue dans les fibres supérieures du papier, est d'autant plus vulnérable aux agents polluants qu'elle n'est protégée par aucune émulsion. Le papier salé a néanmoins l'avantage d'être moins cher que le daguerréotype, et d'autoriser la retouche et l'application de couleurs. Autour de 1850, il est supplanté par le papier albuminé de Blanquart-Evrard, qui fait sortir l'image des fibres pour l'inclure dans une mince couche à la surface de la feuille. Rendue plus lisse par le blanc d'œuf, celle-ci donne des épreuves brillantes ou satinées d'une finesse et d'une densité accrues. Après l'exposition, dont la durée diminue sensiblement, le tirage est viré à l'or pour stabiliser l'image et augmenter la profondeur de ses tonalités. C'est sur ce papier que des milliers d'épreuves seront tirées entre 1851 et 1855 dans l'Imprimerie Photographique de Blanquart-Evrard, première entreprise de traitement industrialisé des épreuves. Le papier charbon inauguré par Poitevin en 1855 offre aux images une texture encore plus charnelle. Le support est ici enduit d'une gélatine bichromatée, additionnée d'un pigment - noir de fumée ou charbon végétal - pulvérisé. La gélatine devenant insoluble sous l'action de la lumière, l'image se forme en dépouillant l'épreuve de ses pigments non insolés avec un mélange de sciure de bois et d'eau - opération qui laisse une large marge d'interprétation. D'une finesse pouvant égaler celles de l'argent, le charbon conjugue en outre la stabilité à la beauté de sa matière. Disponibles dans une grande variété de teintes, allant du noir au bistre, les pigments sont fabriqués industriellement par la Compagnie Autotype à l'usage des procédés d'héliogravure. Cette technique sera très utilisée dans le dernier quart du XIXème pour l'illustration de livres et l'édition commerciale de photographies. Elle est aussi adoptée par les pictorialistes, qui cherchent à revaloriser, contre la banalisation croissante des savoir-faire photographiques, une esthétique de l'intuition et de la sensibilité visuelle, voire tactile. Les tirages à la gomme bichromatée, où la gélatine est remplacée par de la gomme arabique, séduisent également ces nouveaux créateurs, parce qu'ils permettent d'intervenir manuellement sur les valeurs de l'image. Combinant l'empreinte d'un geste à celle de la lumière, le papier retrouve ainsi toutes ses potentialités graphiques, dont le prestige est encore rehaussé par le tirage limité, lorsque Demachy, Steichen ou Puyo vendent encadrées des épreuves dont les négatifs ont été détruits. Parmi ces prestigieux supports, figureront aussi le papier Artigue et le papier Fresson. Le premier évite d'avoir à transférer la couche sensible après son insolation, comme l'exigeaient les premiers tirages au pigment. Très mat, il est commercialisé en 1894 sous le nom de "charbon-velours". Le second, où le pigment est étendu sur une couche de gélatine brillante, se distingue par son aspect plus lustré. A partir de 1899, il est proposé en un grand nombre de couleurs et de papiers différents sous le nom de "charbon-satin". Si ces procédés continueront d'être utilisés jusqu'à nos jours, ils seront toutefois relégués à partir de 1870 par les émulsions gélatinées aux sels d'argent. Dans cette nouvelle génération de papiers, une sous-couche de gélatine est introduite entre les fibres et le liant contenant l'image. Au premier rang de ces supports, figure le papier au gélatino-bromure d'argent, mis au point par Mawdslet. Très sensible, il autorise l'agrandissement par projection, alors que les tirages ne pouvaient jusqu'alors être réalisés que par contact. Il contribue ainsi à réduire le format des négatifs, dont dépend la démocratisation des pratiques photographiques. Aujourd'hui encore, il est le plus répandu des papiers utilisés. L'aristotype à noircissement direct d'Abney est quant à lui l'un des premiers supports à être fabriqués industriellement sur des machines à cylindre, aux alentours de 1882. D'un traitement simple, il participe lui aussi à l'augmentation du nombre d'amateurs, au même titre que les papiers autovireurs (au prix rendu toutefois plus dissuasif par les sels d'or incorporés à leur émulsion). Le papier Gaslight inaugure enfin en 1884 le tirage en lumière artificielle : l'exposition ne dépend plus de l'ensoleillement, et chacun peut désormais improviser un laboratoire à la lumière du gaz… Après l'invention du gélatino-bromure d'argent, la fabrication des papiers noir et blanc ne connaît plus d'évolution majeure. Chimiquement stable, physiquement résistante, ne jaunissant pas et pouvant gonfler jusqu'à multiplier plusieurs fois son volume, la gélatine restera la base de la plupart des émulsions photographiques. Quant aux sels d'argent, ils s'imposent finalement face aux autres composés comme le platine, qui donne un papier plus stable et d'une plus grande variété de grains et de couleurs, mais d'un prix de revient beaucoup trop élevé. Peu à peu, " à la richesse des tonalités et au caractère artisanal des images du XIXème, ont succédé des épreuves en noir et blanc dont les possibilités plastiques se sont appauvries en fonction d'impératifs industriels". Dans les vingt dernières années, les effets de cette standardisation se sont d'abord signalés par la diminution du nombre de gradations proposées pour chaque papier. Dans un deuxième temps, l'invention par Ilford du papier à contraste variable a rendu caduque la notion même de grade fixe. Le principe, qui consiste à dédoubler l'émulsion en deux couches sensibles à des colorations différentes, permet de tirer avec le même papier des négatifs de n'importe quel contraste ou de modifier localement le contraste d'une image. Le travail du tirage et le stockage sont donc simplifiés, au prix d'une réduction de la gamme des produits mis sur le marché. Les émulsions voient ensuite baisser leur teneur en argent, dont dépend la qualité des noirs, plus ou moins "profonds", ainsi que leur épaisseur. Kodak Elite, Guilleminot carte, Ilford Galerie, Oriental Seagull… l'un après l'autre, les plus prestigieux des papiers bromures sont tous retirés de la vente. S'ils sont unanimement prisés par les professionnels, les sociétés d'émulsionnaires estiment quant à elles qu'ils ne leur permettent pas de réaliser des marges suffisantes… C'est ensuite au support-papier de subir les effets d'une stratégie industrielle qui cherche à réduire les coûts de production en réduisant son épaisseur et sa résistance. Dans les années 1970, apparaissent les papiers RC (resin coated), dont l'émulsion est couchée sur une pellicule de plastique, pour empêcher l'absorption des liquides et permettre un traitement plus rapide en usine. Depuis, ils remplacent progressivement les papiers barytés à fibres de bois, bien qu'ils soient d'un toucher moins agréable, d'une moindre précision et d'une conservation beaucoup plus aléatoire. Très sensible à la chaleur et à l'humidité, la couche plastique n'a pas le même coefficient de dilatation que le papier, et elle a tendance à se rétracter en faisant apparaître des micro-fissures. Exigeant un lavage rapide, ils laissent en outre en suspension des sels de traitement accélérant la destruction de l'image. Enfin, ils interdisent grattages, retouches et autres pratiques de métier. Alors que dans les années 1950, les photographes pouvaient encore choisir leur support dans une large gamme, en fonction d'un choix esthétique (notamment parce que chaque papier présentait une tonalité plus ou moins chaude et un toucher différent), beaucoup de praticiens sont aujourd'hui insatisfaits des produits mis à leur disposition. Il ne leur reste alors qu'à recourir à des circuits de fabrication plus confidentiels, ou à revenir aux origines, en couchant eux-mêmes leur émulsion sur des matériaux de qualité. S'approvisionner en papiers capables de résister à de nombreux traitements physiques et chimiques n'est toutefois pas toujours facile, d'autant que les besoins varient en fonction des manipulations : les exigences porteront tantôt sur l'acidité ou la pureté, tantôt sur l'épaisseur ou le grain. Mais " essayez d'expliquer à un fabricant de papier qu'il vous faut un papier qui se tienne bien dans l'eau. En général, la réponse est invariable : pourquoi voulez-vous donc mettre du papier dans l'eau ? " C'est sans doute en réaction à cette standardisation que la pratique des procédés anciens comme la recherche de l'image unique reviennent en force dans la production artistique de ces dernières années. Transférée ou couchée sur des surfaces non photographiques (papier BFK, plexiglas, bois, plomb, papier journal…), ou marquée par des altérations physiques et chimiques (oxydations, rayures, virages), la photographie retrouve alors une autre matérialité, loin du jetable et du prêt-à-photographier. L'évolution technologique a aussi eu pour effet de favoriser une création en couleur, alors que le noir et blanc a longtemps été le seul à pouvoir revendiquer une étiquette artistique. Depuis la mise au point des papiers Ektacolor et Cibachrome vers 1955, la recherche des grandes firmes a essentiellement porté sur ce secteur, qui représente une part toujours croissante de la consommation mondiale. Modeste contrepartie à la politique d'uniformisation : " en couleur, il n'existe pas de neutre : à chaque papier correspond un certain rapport entre les tonalités, et chaque marque a sa signature, même si aucune ne s'en vante dans sa promotion ". L'accent mis sur la couleur dans la photographie contemporaine aura néanmoins un prix, celui de la conservation, car les tonalités des procédés chromogènes commencent à changer après une quinzaine d'années seulement. Si l'avenir de la création peut souffrir de cette logique de marketing qui domine la fabrication des papiers, on peut aussi s'interroger sur sa validité par rapport au marché qu'elle est censée viser. Explicitement ciblée sur les amateurs, une telle stratégie suppose en effet que le commun des photographes serait indifférent à la qualité-papier de ses images. Or, même si la tendance au prêt-à-photographier répond sans doute à une attente, les consommateurs n'en sont pas moins très exigeants quant au résultat de leurs prises de vue. Car la photographie de famille ou de vacance est toujours plus qu'une image : c'est un objet qui se touche et s'échange, se déchire et se colle, s'affiche et se cache. Si l'on s'attend à ce qu'une épreuve vive et vieillisse, on attend donc aussi qu'elle résiste aux usures d'une vie et qu'elle passe, de génération en génération. L'épreuve du tempsIgnorer la matérialité de l'image pour ne considérer que ce qu'elle montre : telle a été la première cause de détérioration du patrimoine photographique qu'on s'efforçait parallèlement de constituer à travers missions et commandes. Parce qu'on ne voyait que leur "contenu" documentaire, les épreuves ont longtemps été accumulées dans les collections publiques ou privées sans plus d'égard pour leur papier que pour leur émulsion. Reproductibles, elles n'étaient que des passeuses de sens, sans matière ni durée de vie. Aujourd'hui, on regarde autrement ces images des premières expéditions d'Egypte, des insurgés de la Commune ou du vieux Paris disparu… à condition qu'elles soient encore visibles. Car les supports photographiques sont non seulement fragiles, mais chimiquement actifs, et peuvent se nuire mutuellement au contact les uns des autres. " Les nitrates agissent ainsi comme de véritables cancers, en dégageant des gaz toxiques qui détruisent les épreuves situées à proximité. Même si le support de la couche image est sain, le cliché n'est donc pas à l'abri d'une multitude d'altérations qui proviennent de son environnement ". Les cartons de présentation sont par exemple un souci constant pour les restaurateurs. A l'époque des tirages albuminés, on avait coutume de contrecoller l'épreuve pour éviter que son émulsion ne se rétracte. Or ces "cartons bleus" représentent un véritable danger pour les images qu'ils étaient censés protéger : composés de plusieurs feuilles de papier à base de pâte de bois blanchie collées entre deux feuilles de papier chiffon, ils exposent l'épreuve au vieillissement de la colophane, qui jaunit et devient pulvérulente, et à l'acidité de la pâte, qui réagit à tous les éléments atmosphériques. " La restauration de ces images contrecollées est d'autant plus problématique que c'est souvent sur le cartons que figurent marques de fabrication, estampilles ou signatures, que l'on doit s'efforcer de conserver. Il faut toutefois dans certains cas dissocier l'image de son carton, pour sauvegarder l'information qui risque tout simplement de disparaître ". Le tournant pris par l'industrie papetière autour de 1850 vers une mécanisation croissane n'a donc pas seulement condamné des milliers de livres à tomber aujourd'hui en poussière dans nos bibliothèques : il a aussi gangrené les photographies, dont la production s'est précisément accentuée au même moment. Les épreuves sont en outre sensibles à toutes les manipulations qu'elles subissent au cours de leur existence. Des pratiques d'atelier à l'exposition, en passant par l'archivage, la consultation et le transport, elles doivent affronter empreintes digitales, cassures, émanations provenant des peintures ou des colles utilisées sur les cimaises, dégradations des films de protection UV qui dégagent du chlore, etc. Enfin, lumière, humidité, température et pollution atmosphérique attaquent les colorants, la gélatine ou l'argent, entraînant des réactions photochimiques parfois irréversibles. Sans doute faut-il se résigner à ce que les milliards de photographies réalisées chaque jour dans le monde soient pour la plupart appelées à disparaître d'ici peu de temps. Mais si l'on reconnaît à certaines d'entre elles un droit de cité dans notre patrimoine, alors il serait urgent de penser à mettre en place une véritable politique mémorielle, qui toucherait non seulement la conservation, mais aussi la production des papiers photographiques. De l'image sans support au papier retrouvéParvenus à ce stade de leur évolution technique, industrielle et culturelle, il reste aux supports photosensibles à négocier un tournant autrement plus décisif : celui du numérique. A l'heure où les émulsionnaires rivalisent d'effets d'annonce pour prophétiser l'arrêt de l'argentique d'ici une dizaine d'années, quel peut être l'avenir de l'image photographique sur papier ? Pour les professionnels de l'information, de la communication et de l'édition, il va sans dire qu'un court-circuit du papier dans la fabrication et la transmission des documents visuels représente une avancée déjà largement amorcée. Ces secteurs, qui préfèrent depuis longtemps le film ou l'ekta au bromure, n'ont guère d'exigence sur la qualité des papiers et sont prêts à passer rapidement au tout-numérique. Les amateurs, qu'on cherche à séduire à grands coups de publicité, sont en revanche sans doute moins disposés à convertir leurs photos souvenirs en pixels et leurs albums en écrans d'ordinateur. Car les usages affectifs, fantasmatiques ou symboliques de la photographie ne se détacheront pas si facilement de la matière où ils prennent corps. Pour la plupart d'entre nous, une image numérisée est encore une image sans support. Elle flotte de programme en programme, sans autres définition, tonalité ou format que ceux des surfaces scintillantes où elle s'affiche passagèrement. Surtout, elle n'a pas cette profondeur, que les quelques microns d'un négatif ou d'une émulsion suffisent à procurer à l'argentique. " Alors que la continuité photographique assure au regard une vision tactile, objectale, entre les pixels, il y a du vide. Et l'on peut se demander si une image transparente est encore une image ". Logiquement, les praticiens engagés dans une démarche artistique sont encore plus sensibles à ces valeurs que le numérique ne peut encore égaler. Ils repèrent la limite trop découpée des ombres et des lumières propre à un signal discontinu. Ils voient les milliers de gris que peut offrir une émulsion, quand les écrans n'en proposent que 256. Ils connaissent l'infinie variété des noirs, et la sensualité des détails qui se lèvent dans les hautes lumières. Ils savent qu'un support satiné peut enterrer une image alors qu'une surface brillante donne de l'éclat aux couleurs, mais diminue sa profondeur… Pour eux, traiter une photographie, ce n'est pas interchanger des calques et des filtres sur Photoshop, mais " travailler une matière : […] comme un sculpteur qui part de la pierre brute, ici le négatif, c'est sculpter la lumière pour faire apparaître une image sur le papier ". Mais, si elle n'a pas les caractères d'une épreuve d'argent, l'image numérique n'en a pas pour autant fini avec le papier. Certes, les tirages effectués sur imprimantes jet d'encre ou à sublimation thermique ne relèvent plus d'une esthétique ou d'une mystique de la révélation. Ils donnent néanmoins des résultats parfois spectaculaires, bien que d'une stabilité encore bien inférieure à celle de l'argentique. Le jet d'encre continu, utilisé par les imprimantes Iris, permet notamment de réaliser des tirages d'exposition, non seulement sur papier couché, mais aussi sur Vélin d'Arches blanc, Aquarelle Arches satiné ou tout autre type de papier fourni par le client. Face à l'appauvrissement des papiers photographiques, le numérique pourrait donc bien, paradoxalement, restituer aux images le goût de leur propre texture, en consacrant le retour des beaux papiers. Certes, la photographie devra pour cela renoncer à la magie de l'empreinte photochimique. Mais elle retrouvera le tissu, et les accidents qu'il décharge dans la lisibilité des formes et des figures. Emulsion, trame ou pigment : la force des images est de savoir s'humilier dans une matière. Merci à Pierre-Emmanuel Nyeborg, de l'Atelier de restauration et de conservation des photographies de la Ville de Paris, et à Philippe Guilvard, tireur couleur indépendant pour les entretiens qu'ils ont bien voulu m'accorder.
Ce texte de Louise Merzeau a été publié dans les Cahiers de médiologie n°4 :"Pouvoirs du papier" (Gallimard, 1997) et repris sur galerie-photo avec l'aimable autorisation de l'auteur
dernière modification de cette page : 2002
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||