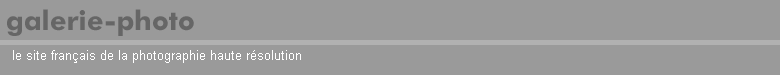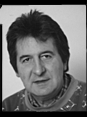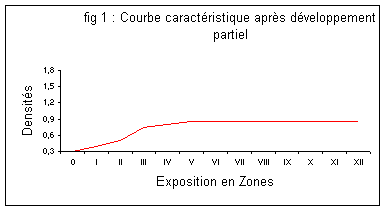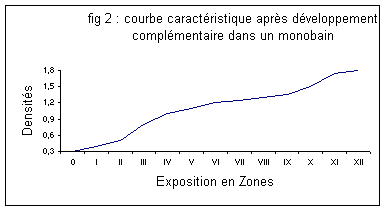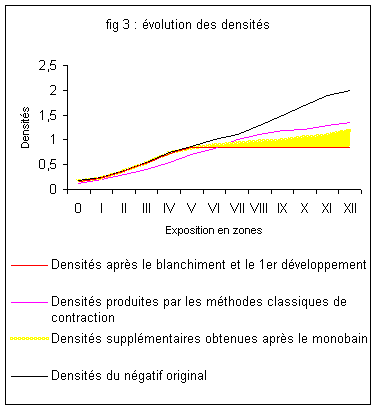Techniques de compression
en tirage Noir & Blanc
Un certain nombre de photographes utilisant le Zone System ont la
fâcheuse habitude de parler de contraste pour désigner l'étendue de
brillances d'un sujet ou la gamme de densités d'un négatif. Ces deux
notions sont en réalité très différentes: le contraste d'un négatif
s'exprime par la pente de la courbe caractéristique du film et est
déterminée uniquement par les conditions de développement. Le
contraste ne dépend aucunement de l'étendue de brillances du sujet.
Ainsi, un négatif de contraste moyen (G = 0,6 par ex.) peut aussi
bien renfermer une étendue de brillances correspondant à 4 zones, 10
zones ou plus suivant le sujet. Il demeure néanmoins un négatif de
contraste normal. De même, un négatif développé pour un faible
contraste (G = 0,35 par ex.) reste un négatif à faible contraste
même si le sujet photographié renfermait 12 zones ou plus. Cette
mise au point est d'une importance capitale pour comprendre les
avantages ou inconvénients de certaines techniques de compression
présentées ci-après.
La compression du négatif
Les photographes qui tirent eux-mêmes leurs images
connaissent les limitations de leurs matériaux noir & blanc,
négatifs ou positifs. Si un négatif est capable d'enregistrer une
forte étendue de brillances (15 zones, voire plus) le papier, lui,
n'est en mesure de restituer que les 8 ou 10 premières et sature au
delà. Lorsqu'un sujet comporte plus de 10 zones de brillances, il
convient de comprimer sur le négatif la gamme de densités afin de
rendre ce dernier compatible avec les capacités d'enregistrement du
papier.
Techniques de compression habituelles
Les techniques de compression classiques (réduction
de la durée de développement, révélateur très dilué, etc…) sont
toutes basées sur le même principe: le sous-développement du
négatif. Or un sous-développement produit un négatif de plus faible
contraste local qu'un développement nominal, avec une moins bonne
séparation des tons notamment dans les ombres et les hautes
lumières. Cet inconvénient s'accompagne aussi d'une perte de
sensibilité et l'apparition éventuelle de zones non homogènes si le
sous-développement est important.
Les films actuels sont conçus pour être développés
normalement et répondent mal à un fort sous-développement. Les
techniques de compression classiques sont donc mal adaptées à des
compressions importantes (plus de N-2) Il convient de rechercher
d'autres méthodes permettant une compression importante des densités
tout en développant le négatif dans des conditions normales de
durée, de température, de dilution et d'agitation.
Nouvelles techniques de compression
Ces techniques ne sont en fait pas nouvelles puisque
elles ont été appliquées dés le début du siècle dernier, puis sont
tombées dans l'oubli des photographes. Les travaux récents de David
KACHEL aux USA les ont fait resurgir de l'ombre. Ces techniques sont
basées sur le blanchiment préliminaire de l'image, quelle soit
argentique (technique n°1) ou latente (technique n°2). Une idée
encore jamais explorée par les photographes du Zone System.
Technique n°1: La méthode du monobain
Un monobain est un révélateur qui contient aussi un
fixateur. Du fait de sa forte alcalinité, le développement se
produit avant que le fixage n'agisse. L'intérêt du monobain est sa
forte tendance à fixer rapidement les faibles densités du négatif et
à développer plus longuement les fortes densités. La méthode
s'applique à posteriori sur des négatifs déjà développés et fixés
dont on veut réduire la gamme des densités.
La première phase consiste à blanchir le négatif à
compresser dans un bain de ferricyanure de potassium (voir table 1),
puis à le re-développer partiellement dans un révélateur très dilué
(voir table 2) afin de ne faire apparaître que les faibles densités
(zones I à III). A ce stade, le film a une courbe caractéristique du
type de celle représentée à la fig1.
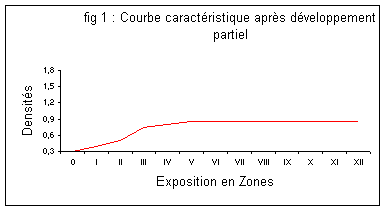
Les densités correspondant aux tons moyens (zones IV
à VI) et aux hautes lumières (zones VII et au delà) sont ainsi
laissées sous-développées, en attente d'un développement
complémentaire dans le monobain (voir table 3) .
Comme le monobain a tendance à fixer plus rapidement
les faibles densités, les densités moyennes (qui correspondent aux
plus faibles densités restant à développer dans notre négatif) vont
être développées moins longuement que les fortes densités, et un
effet de compression sera atteint dans la gamme moyenne du négatif.
Les ombres et les hautes lumières ne seront pas affectées dans leur
contraste local. La courbe caractéristique finalement obtenue est du
type de celle représentée à la figure 2.
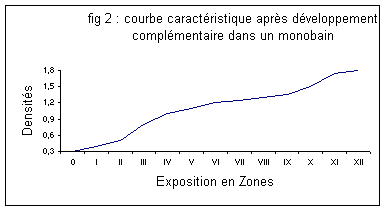
La figure 3 ci-dessous illustre l'évolution des
densités du négatif au cours des différentes étapes de la méthode:
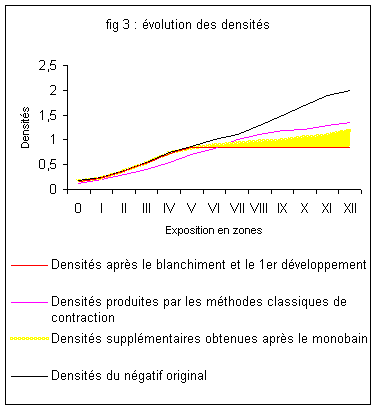
En résumé, les étapes de la méthode du monobain sont
les suivantes:
-
Blanchiment complet du négatif
-
Rinçage
-
1er développement dans un révélateur très dilué,
jusqu'à apparition des basses lumières
-
Rinçage
-
2ieme développement dans le monobain
-
Bain d'arrêt
-
Fixage
-
Lavage et séchage
Les tables en annexe donnent la base de départ à la
fabrication des différents bains. A partir de ces bases, des
compressions de 0,4 à 0,6 unités de densités, soit N-2 à N-3,
peuvent être obtenues. Des compressions plus importantes (jusqu'à
N-10) peuvent être obtenues en augmentant la quantité de fixateur
(thiosulfate de sodium) par incréments de 10 à 20g, ou en diminuant
la quantité de révélateur (métol) par incréments de 0,5g, ou encore
en combinant les deux. A chacun de régler sa méthode!
Technique n°2
Bien que très efficace la méthode du monobain n'est
peut être pas à la portée du débutant. Pour ceux qui préfèrent une
méthode plus simple et adaptée à des compressions plus faibles (N-1
à N-4), je propose la technique suivante qui est basée sur le
blanchiment de l'image latente, et donc s'applique à des négatifs
exposés mais non encore développés.
Après blanchiment préliminaire dans une solution de
ferricyanure de potassium (voir table 1), le négatif est développé
normalement dans votre révélateur habituel. Oui, normalement, c'est
à dire que le négatif blanchi peut être développé avec d'autres
négatifs normaux dans les conditions normales de durée, température,
etc… Une compression des densités se produit parce que le
blanchiment détruit davantage l'image latente dans les zones de
forte exposition. Ainsi, les zones d'exposition excessive n'existent
plus au moment du développement et le négatif peut être développé
normalement. Il en résulte une diminution du contraste du négatif
sans perte notable de sensibilité ni risque de développement
irrégulier.
La table 1 donne une base de départ pour le réglage
de la méthode, mais la dilution du bain de blanchiment doit être
ajustée en fonction de la compression désirée et du couple film /
révélateur utilisé (il est possible que des dilutions très
supérieures
(X10 ou X100) soient requises).
Annexe
|
(Techniques n°1 et 2) |
(Technique n°1) |
|
Table n°1: Blanchiment |
Table n°2: Premier révélateur |
|
Ferricyanure de potassium: 11g
Bromure de potassium: 12,5 g
Eau pour faire: 1000ml
Pré-mouiller le négatif avant blanchiment.
La durée optimale du blanchiment est de 4 à 5 minutes à 20°C.
Ajuster la dilution en conséquence. Bien rincer après
blanchiment. |
Métol: 0,5 à 1g
Sulfite de sodium: 2,5 à 5g
Carbonate de sodium: 2,5 à 5g
Eau pour faire: 1000ml
Les dilutions et durée de développement doivent être réglées pour
obtenir un développement complet des zones I à III. Les zones IV
et suivantes doivent présenter un affaiblissement important. |
|
|
Table n°3: Monobain |
|
|
Sulfite de sodium: 6g
Métol: 2g
Thiosulfate de sodium: 40g
Hydroxide de sodium: 5g
Eau pour faire: 250ml
Le développement complet des densités moyennes et hautes est
réalisé en 30 secondes. Ne pas développer plus de 60 s.
Utiliser un bain frais pour chaque négatif. Aussitôt après le
monobain, plonger le négatif dans un bain d'arrêt et fixer. |
dernière modification de cet article
: 2000
|