Analyse d'image
Degas : Jeunes Spartiates
par Henri Peyre
La cible
Nous entreprenons ici
l'étude d'une peinture de jeunesse de Degas
:
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/hilaire-germain-edgar-degas-young-spartans-exercising
Le titre de cette
œuvre de Degas est peu établi. On
peut trouver l'œuvre sous le nom de
l'éducation des spartiates, ou de
Petites filles spartiates
provoquant des garçons.
Edgar Degas était
très attaché à cette œuvre complexe,
réalisée vers 1860, dont il ne se
sépara jamais.
Nous reproduisons ci-dessous un
reflet de cette œuvre (pour ne pas
enfreindre les droits d'auteur).
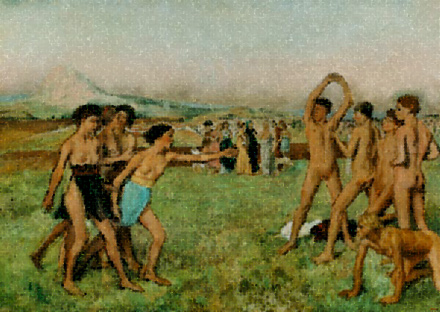
Le tableau est
intéressant par l’impression que l’image est
particulièrement stylée et contrainte. Sa
richesse tient beaucoup à la gestuelle des
différents personnages. Le décryptage des
postures révèle du sens, explique les
impressions du spectateur et, conduit à son
terme, permet de mieux apprécier le tableau.
Composition et sens
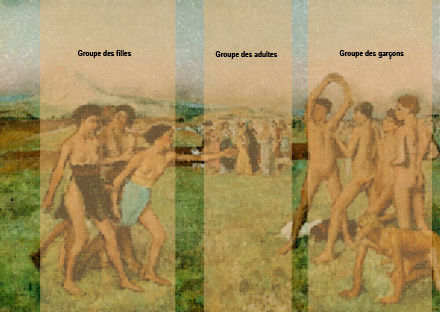
Trois groupes de personnages sont
représentés, assez nettement détachés les
uns des autres :
- le groupe des filles,
- le groupe des garçons,
- le groupe des adultes.
Le premier coup d'œil, avec la perception de
ces groupes, fait penser au spectateur que le sujet du
tableau risque d'être celui des rapports entre ces
différents groupes.

A l'heure des études de genre, la question
vient tout de suite à l'esprit : qui domine
?
Les têtes des garçons sont placées au-dessus
de celles des filles (si l'on élimine de
l'analyse le premier des garçons) et
au-dessus de celles des adultes. La première
impression pourrait donc être que les
garçons sont dominants. Toutefois, un regard
sur les pieds révèle un étagement
perspectif, conduisant à reconnaître une
imbrication des plans des groupes de filles
et de garçons. Cette deuxième interprétation
ne laisse pas le garçon du premier plan
en-dehors de l'analyse, et est donc plus
intéressante :
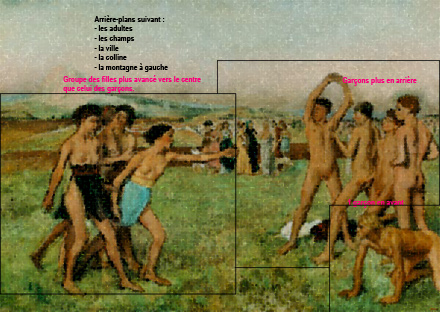
2 plans sur les garçons encadrent le plan où
sont regroupées les filles, tandis
qu'adultes et fond de paysage jouent les
figurants dans le lointain.
L'action apparaît ainsi comme imbriquée dans
le sens de la profondeur du tableau, alors
qu'elle n'est pas imbriquée dans le sens
horizontal, chaque groupe étant nettement
isolé dans l'espace.
L'impression est donc que garçons et filles
qui sont nettement séparé sur la surface du
tableau ont à voir malgré tout dans la même
scène.
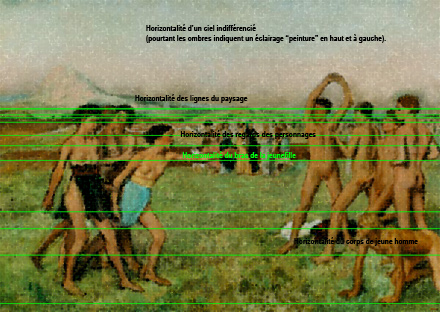
Un très grand nombre d'éléments jouant sur
des horizontales travaille à réunir les
acteurs de la pièce :
- Le ciel est indifférencié dans sa lumière,
de gauche à droite (alors que l'éclairage,
si l'on considère les ombres, vient du haut
gauche du tableau).
- Les lignes du paysage d'arrière-plan
portent de solides bases horizontales.
- Les regards qu'échangent les personnages
sont largement horizontaux.
-L'élément le plus fort de l'horizontalité
est le bras de la jeune fille, porté droit
vers le groupe de garçons.
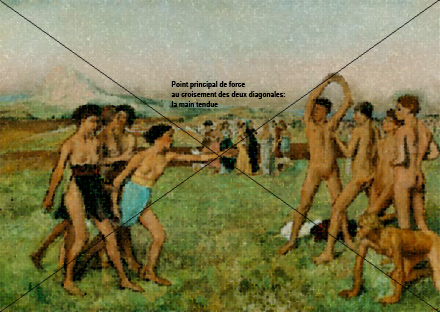
L'extrémité du bras de la jeune fille arrive
au point le plus fort de la composition :
traditionnellement le croisement des deux
diagonales, centre du tableau, du regard du
peintre et du spectateur. Une conclusion
s'impose : les filles mènent l'action. Les
garçons ne dominent pas. On les provoque.
Et pourtant, en réalité, qui provoque ?
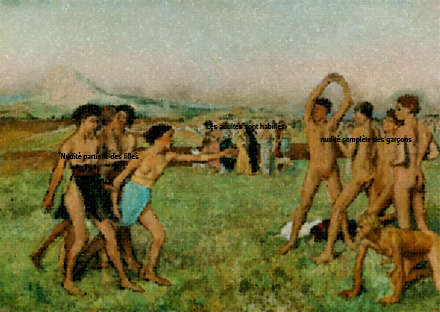
La nudité des garçons est complète, les
vêtements enlevés sont dans l'herbe ; tandis
que les filles sont à demi-nues, poitrine à
l'air. Les adultes de l'arrière-plan sont
eux tout à fait habillés.
Les garçons provoquent à la sexualité des
filles qui ne semblent pas indifférentes.

La provocation sexuelle, objet du tableau,
est renforcée par ce personnage du premier
plan. Il est surnuméraire. Il y a 4 filles
d'un côté et 4 garçons plus lui de
l'autre. Par ailleurs, il présente une posture
bien étrange : à quatre pattes comme un
animal.
Dans ce petit jeu dont on voit parfaitement
où il va mener, qui provoque, qui désire,
qui tempère ? La position des mains des uns
et des autres est éloquente :
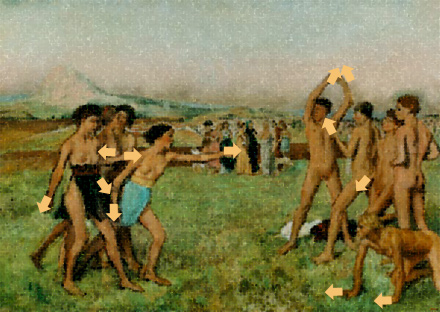
La fille du centre de l'image porte une main
complètement engagée à l'horizontale vers le
groupe des garçons, mais sa deuxième main
tournée vers le bas l'ancre malgré tout au
même endroit où elle est encore . Le jeune
garçon en bas à droite de l'image montre une
attirance bien plus grande pour le groupe
des filles : ses deux mains sont
complètement tournées vers elles. Rien ne
peut plus le retenir. Une deuxième fille,
dont on ne voit qu'une main tournée elle
aussi complètement vers les garçons, est
retenue à grand peine par la fille du fond,
dont la main visible retient l'élan de la
précédente. La dernière fille à gauche n'est
pas disposée à bouger : ses mains pointent
également plutôt vers le bas et de façon
symétrique par rapport à la verticale. Deux
autres garçons présentent une main seule
tournée vers les filles. Ils sont plutôt
décidés à y aller. Un troisième ne montre ni
ses mains ni ses intentions. Le dernier
garçon lève deux mains symétriques et
neutres par rapport aux filles, mais c'est
pour mieux exhiber son sexe offert aux
jeunes femmes.
Conclusion
On peut discuter du
titre de cette œuvre à la lueur des quelques
éléments fondamentaux repérés. Il ne nous
semble pas qu'un titre comme Petites filles spartiates
provoquant des garçons ne soit très
juste. Les garçons ne sont pas nus par
hasard. Ce sont eux les provocateurs. Deux
filles sont fortement tentées comme leurs
mains l'indiquent. Mais le plus excité de
tous est bien ce personnage aux deux mains
tendus vers les filles qui est au premier
plan dans une posture animale. C'est lui,
malgré tout, qui donne le sens de ce tableau
où, à première vue, le bras de la fille jouait
le rôle le plus actif. Il est le personnage
le plus avide qui révèle le mieux ce qui est
en cause dans ce tableau étrange où les
groupes semblaient séparés. La sexualité des
garçons s'exerce en moteur, dans un schéma
d'offrande. Les filles décident et le
tableau montre le moment de la décision avec
ce bras levé de la fille au croisement des
diagonales.
La gestuelle très
travaillée semble bien
classique. Mais le classicisme artistique et
sa maîtrise ne font que souligner par
opposition les contraintes et la violence
d'un instinct toujours prêt à se libérer.
dernière
modification de cet article : 2018
|

