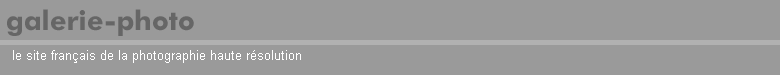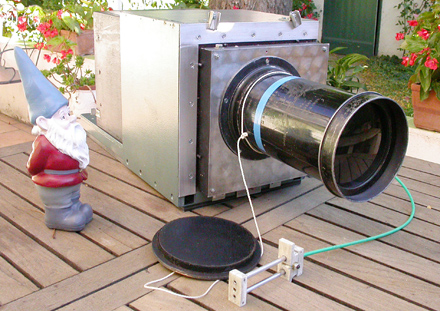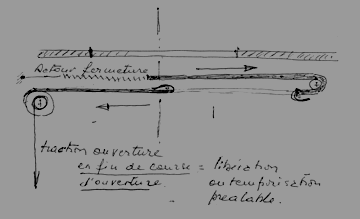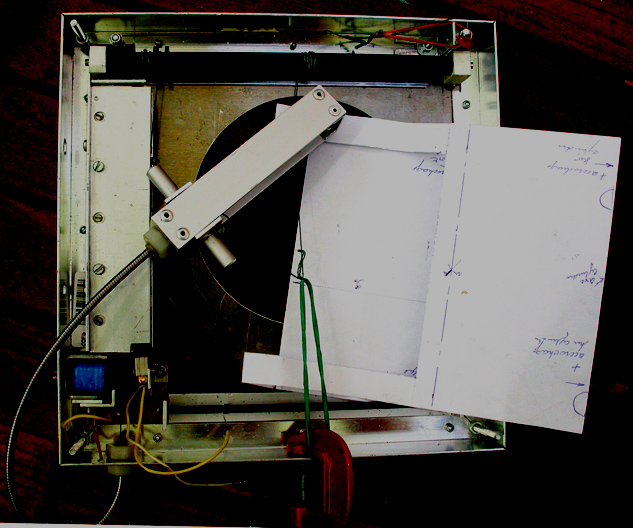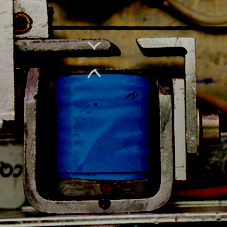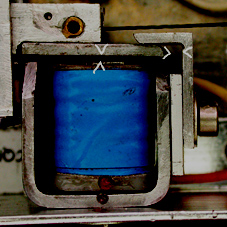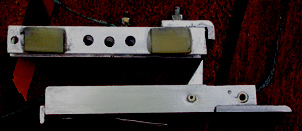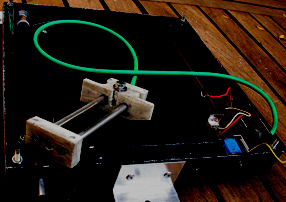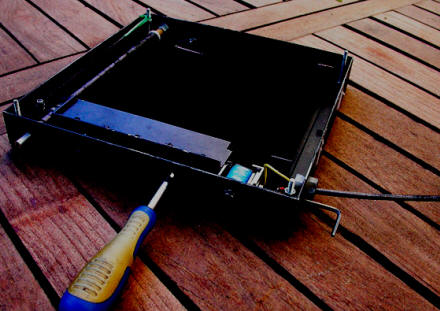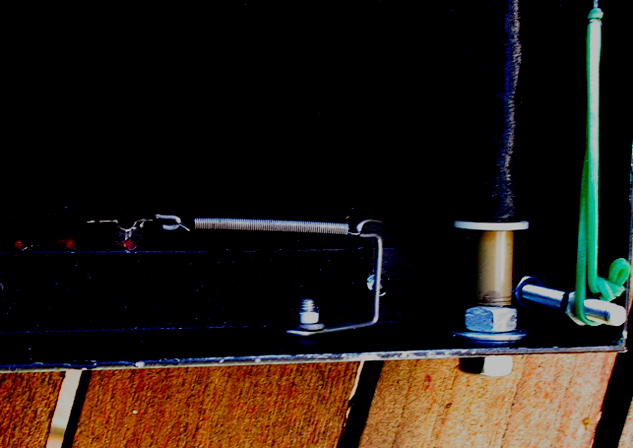[abonnement gratuit]
l'auteur
|
Jean-Louis Maignaut

retraité, ancien cadre dans un établissement de la Cie de St Gobain
(céramiques industrielles) où il a œuvré dans différents services :
techniques, contrôle qualité, informatique, etc. A fait ses premières
photos dans les années 50.
maginwald@orange.fr
|
|
|
Construire un obturateur de grande taille
par Jean Louis Maignaut
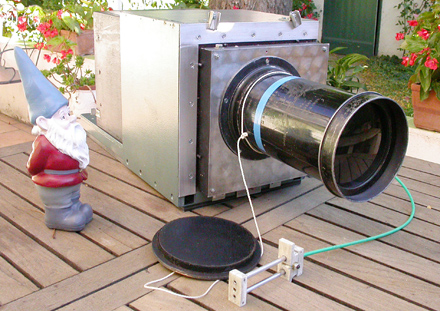
Pourquoi construire
un obturateur de grande taille ?
C'est la troisième et dernière phase d'une
« Aventure » qui a démarré avec la remise en route d'un vieil objectif
Dallmeyer 4A (457 mm, f/4) à flou variable, suivie de la construction
d'une chambre à tiroir pour pouvoir l'utiliser. Même en lumière faible
avec les surfaces les moins sensibles encore disponibles, les problèmes
sont fréquents à moins de diaphragmer fortement, ce qui ne permet pas
d'utiliser l’objectif à l'ouverture pour laquelle il est censé donner le
meilleur de son flou : L’optique pour laquelle j’ai effectué ce travail
est un 457 mm ouvrant à f4 de type soft focus variable. Si l’on veut
l’utiliser aux ouvertures maximales (4 à 5,6) pour bénéficier de la
fonctionnalité "soft" dans des conditions d’éclairage courantes et avec
des films de 100 ISO ou plus, on se trouve souvent confronté à des
durées d’exposition minimales qui ne peuvent être assurées "au béret" ne
serait ce que pour éviter un "bougé" (en portrait par exemple) ou une
surexposition trop importante. Evidemment il est illusoire d'espérer obtenir des
vitesses supérieures au 1/50° avec des ouvertures mécaniques de l'ordre
de 120 mm de diamètre avec ce choix de fonctionnement. Exposer plus de 1
seconde au bouchon ou au béret ne requiert aucune qualité particulière
si ce n'est de ne pas être affecté par la maladie de Parkinson ou le
bégaiement. Seuls Lucky Luke et les diplômés de l'ENSP(olice) peuvent se
targuer de « shooter » au ¼ de seconde au béret.
Le challenge est de pouvoir couvrir la gamme entre 1 seconde et un
fulgurant 1/15° à F/4 sans filtre gris ou sans obligation d'opérer au
lever du jour ou d'attendre la tombée de la nuit. Paradoxalement, les
technologies actuelles peuvent venir à notre secours sans problème et il
est possible (si cela sert à quelque chose) d'envisager le 1/9,3 ou le
1/11,8 de seconde, si l'on sait les mesurer : une pincée de composants
suffit.
Mais avant tout, le plaisir d'expérimenter
et de faire travailler ses dix doigts.
La solution retenue
La version réalisée n'est certainement pas
originale, elle offre la particularité de ne nécessiter qu'une course
réduite du rideau et donc de permettre une vitesse de translation
réduite, ce qui est avantageux au niveau des contraintes. Un avantage
supplémentaire : il y a une course aller et une course retour, ce qui
permet, dans l'intervalle, l'introduction d'une temporisation
(électromécanique) La vitesse de translation est la même pour toutes les
durées choisies on n'est donc pas tributaire des non linéarités de
tension des ressorts.
Pour autant l'encombrement n'est pas réduit.
Il n'y a pas d'armement préalable, l'énergie d'ouverture est fournie par
l'opérateur à l'aide d'un déclencheur/tracteur souple à longue course
(comme pour les obturateurs GITZO qui offraient un diamètre d'ouverture
de 60 à 80mm) avec comme contrainte d'exiger un effort un peu plus
important, ce qui impose de « travailler » la mécanique au mieux en
termes de masses en mouvement et de frottements.
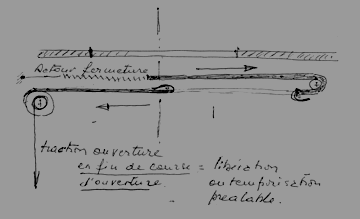
Le plan d'attaque...
Une précision
Bien qu'il utilise un rideau, cet
obturateur se comporte comme un obturateur d'objectif à secteurs ou
lamelles, obturateur dit « central » placé derrière l'optique mais il en
est la version la plus élémentaire car il ne comporte que deux secteurs.
Ne pas confondre avec ceux dit « de plaque » ou le rideau se déplace au
plus près de la surface sensible ce qui permet en jouant sur la largeur
de la fente ou la tension du ressort d'obtenir des vitesses plus
importantes.
Détails de construction
Rien d'extraordinaire, outillage à main,
visserie standard, des rivets et inserts de type POP, quelques chutes
d’aluminium, de Dural et de Téflon, un peu de corde à piano, des restes
de peinture, de la colle, un seul approvisionnement : les tubes d'axes
en carbone pour réduire les masses (2x1 m → une dizaine d'euros et il
m'en reste 2x0,8 m !), des ressorts calibrés (*) et un morceau de tissu.
Tout le monde peut le faire à condition d'être un bon travailleur
manuel, de posséder quelques compétences en technologie et d'avoir sur
ses étagères un stock de bidouilles récupérées pendant des années et
dans lequel on trouve toujours son bonheur et l'inspiration. Bien sûr de
nombreuses feuilles de papier et crayon, et l'indispensable calculette.
Les perfectionnistes peuvent toujours perfectionner et user de
micro-roulements, de la CNC, etc etc... Il s'agit d'une maquette ou d’un
prototype qui, au fur et à mesure de son avancement est repris, modifié
à maintes reprises avec essai de différentes solutions. On ne procède
pas autrement dans l'industrie avant de réaliser une présérie et ensuite
de mettre en production avec des plans cotés et tolérancés.
* Que je n'ai toujours pas trouvé à ce jour.
Il y a sur Internet des dizaines d'adresses mais les informations sont
indigentes, je n'ai trouvé que deux adresses ou l'on trouve toutes les
infos essentielles dans leur catalogue, mais rien pour moi.
Le déclencheur souple
Une particularité : il est à course longue
et travaille en traction
La course effective vaut celle d'un aller simple du rideau (60 mm) plus
un petit quelque-chose (env. 5 à 10 mm) pour le retour où l'ergot
d'entraînement doit repasser en deçà de son point d'accrochage et le
recouvrement à la fermeture. C'est la butée en arrière du
déclencheur/tracteur qui règle la fin de course (quand la palette en fer
doux du coulisseau de traction est bien centrée au-dessus des pièces
polaires de l'électro-aimant) Il est prévu un petit insert avec vis et
écrou de blocage pour ajuster finement cette fin de course.
Comme dit plus haut : le déclencheur travaille en traction, la
gaine « bosse » elle, en compression, donc ne pas utiliser de
tube en plastique souple (silicone) qui va se tasser et se déformer sous
l'effort, ce qui nuit au bon positionnement de la palette.
De même, le Ø intérieur doit être le plus réduit possible (avantage à la
gaine pour vélos) pour assurer un positionnement régulier de la palette.
Ceux qui ont fait de la Résistance des Matériaux → Flexion → Fibre
Neutre, me comprendront.
Du fait de son mode de travail, il est plus facile de le laisser fixé à
demeure sur le boitier qu'un classique déclencheur souple à pression. La
gaine doit être la plus souple possible et d'une longueur suffisante
pour qu'elle ne transmette pas au boitier les contraintes exercées
pendant son actionnement.
La partie électromagnétique
L'électro-aimant a été construit sur la
base d'une bobine de récupération, je n'en ai donc pas la maîtrise. La
palette, entièrement libre, placée à 2mm environ de ses armatures est
attirée convenablement avec une tension de 9 V et 90 mA.
Mais dans le contexte réel d'exploitation, en fin de course, rien ne
fonctionne : la contrainte de dégagement de l'ergot d'entraînement est
trop élevée, même en rapprochant mécaniquement la palette en fin de
course, il faut passer au moins à près de 20 V pour déclencher
nettement. Rien de catastrophique mais cela pose un problème de
logistique pour ce qui concerne la source d'énergie et son
approvisionnement. De plus, c'est bien connu, les piles sont toujours
vides au moment crucial (*). Une autre solution est envisageable mais il
faut revoir le système et son implantation, le prototype va finir par
avoir une allure de guenille.
(*) Bien que le circuit ne consomme au
maximum que pendant la fermeture du micro-switch (fin de course et
retour arrière du coulisseau) si l'on se contente de contrôler des
expositions qui ne sont pas supérieures à la seconde. La pose de type B
est "manuelle" : il suffit de ne pas activer le circuit de temporisation
et de maintenir retenu le déclencheur le temps voulu.
En cours de construction, avec la première version de déclencheur, des
bracelets élastiques pour simuler les ressorts et le patron modèle pour
la découpe du rideau.
|
|
|
|
accrochage des ressorts
Pour le rideau je reste discret, si je me
débrouille bien avec les matériaux solides : bois, plastiques et métaux
divers, je n'ai jamais bricolé de textiles. J'ai donc pris une pièce de
tissus noir en « synthétique » que j'ai enduite avec du silicone noir
pour étanchéité. Les deux bords de fenêtre perpendiculaires au
défilement sont rabattus sur deux brins de corde a piano (comme sur le
Midelly) sinon tout gondole.
Une précaution a prendre (l'expérience étant la somme des erreurs…) : le
sens du tissage, je ne sais si c'est le fil de trame ou de chaine mais
l'un des deux doit être obligatoirement perpendiculaire au sens du
défilement si l'on ne veut pas que les bords du rideau s'effilochent
même enduits (une des extrémités du rideau étant rabattue, collée et
équipée pour l'accrochage des ressorts de rappel, l'autre fixée au
cylindre d'enroulement, et les bords de fenêtre renforcés il n'y a pas
de risque si le tissage est bien orienté).
Premiers essais, premières mesures
Ils se limitent uniquement au travail en
vitesse maximale. Le décrochage « retour » est provoqué
inconditionnellement par un (dé)réglage de la came de pré-abaissement
puis ensuite à l'aide du contact de temporisation alimenté en
permanence.
A ce niveau-là tout se déroule correctement.
La mesure est temporelle, elle donne le
temps qui s'écoule entre l'ouverture et la fermeture du rideau.
La méthode de mesure : elle peut paraître
sophistiquée pour certains, mais je n'ai pas d'autres moyens. Un
faisceau laser (diode laser de récupération d'un stylo pointeur) modulé
en fréquence (10 kHz à ± 0,35 %) est dirigé vers un capteur (photo
transistor ou photodiode) ; entre les deux : le rideau de l'obturateur.
Les impulsions qui passent pendant l'ouverture sont comptées.
Le comptage commence à l'instant ou le premier photon se rue dans
l'ouverture et se termine lorsque le dernier se fait cisailler à la
fermeture. Avec une modulation à 10 kHz il suffit de diviser par 10 pour
obtenir le temps total en ms.
La précision est superfétatoire pour ce genre de mesure.
Une série de 10 volées de 5 mesures (le
compteur permet le cumul) donne une valeur moyenne de 75,6 ms (± 0,35 ms
pour les sodomiseurs de « musca domestica ») avec un écart-type de 5 ms
ce qui fait en moyenne 1/13 de seconde arrondi – On est vraiment très
près de la valeur visée (1/15) mais avec des ressorts plus puissants que
ceux calculés (+26%). Les masses et frottements ont été sous-estimés.
Compte tenu du rendement qui ne dépasse guère les 50 % (il y a un léger
temps d'arrêt au changement de sens) cela doit faire dans les 1/20 «
photométrique »
de lumination (par rapport à un obturateur dont les rideaux se déplaçant
à 300000 km/s démasqueraient la totalité de la fenêtre pendant 1/13 de
s. Des queues de cerise !)
La temporisation
Comme je n'ai pas fait d'études du côté de
Besançon, je n'ai pas opté pour le tout mécanique, la pneumatique ou
l'hydraulique (*) auraient été amusantes mais donneraient à l'ensemble
le caractère d'un site industriel. Reste la banale électronique avec son
petit circuit imprimé. Je ne trouve pas gratifiant de tracer, graver,
percer, un seul exemplaire alors que dans le principe c'est fait pour la
série, et que les remaniements et modifications conduisent souvent à une
réfection totale. J'ai déjà réalisé et testé certains sous-ensembles en
câblage « en l'air », mais pour les mettre en carte je sens que je vais
traîner. D'autant plus que je ne peux la mettre au point tant que je
n'ai pas trouvé les ressorts de rappel convenables.
Pour déclencher le retour, se pose le problème des piles. Je me suis
fixé une tension de 24 V pour être certain d'avoir un déblocage franc et
massif. Cela pose problème avec l'obligation de monter un paquet de
piles en série. J'ai donc réalisé un mini convertisseur DC/DC qui élève
la tension et charge un condensateur comme pour les flash électroniques,
mais qui concilie aussi les vertus du petit bricolo appelé « voleur de
Joules » qui fait le bonheur des bidouilleurs qui font briller une LED
pendant des heures avec une pile que l'on peut qualifier de « archi
rincée ». Le seul inconvénient c'est que la durée de la charge varie
suivant l'usure des piles : 5 à 6 s pour une neuve et 25/30 s pour une
pile « à bout » pour avoir le feu vert du déclenchement. Ce n'est après
tout qu'un problème d'organisation (**). Avec 6 V (4 x 1,5) en entrée
cela semble correct sur maquette, mais apparemment jusqu'à 3,9 V cela
semble tenir la route et, suivant l'état des piles, si l'on laisse
tourner on peut monter jusqu'à 50 V, c'est sans importance et l'on peut
envisager un contrôle qui stoppe le convertisseur (comparateur à
hystérésis) une fois le quorum dépassé, avec relance quand le
condensateur commence à se re-dégonfler (fuites) sur une longue attente.
Une solution plus rustique consiste en un seul interrupteur qui coupe le
convertisseur pendant les opérations préparatoires.
La temporisation est de type RC mais à courant constant compte tenu du
fait que la tension des piles peut varier énormément. (Le travail
demandé à l'obturation ne justifie tout de même pas une temporisation
numérique avec horloge à quartz !)
(*) il y a 50 ans, sur les disques 2316
qui équipaient les ordinateurs IBM 360, les bras qui déplaçaient les
têtes de lecture étaient animés par des actuateurs hydrauliques et ça
allait super vite ! (temps d'accès moyen : 60 ms)
(**) On peut déterminer la valeur minimale
nécessaire du condensateur pour activer correctement l'électro aimant,
et réduire ainsi son temps de charge.
|